Réglementations et certifications
- Affichage obligatoire
- ERP_Normes de sécurité et accessibilité
- Normes accessibilité pour les ERP
- A quel catégorie ERP mon activité appartient?
- Liste des obligations de sécurité des ERP
- Défibrillateur?
- Procédures d'autorisation de travaux
- Marques, propriété intellectuelle et mentions légales
- Réglementation (enseigne, terrasse, vente de boissons alcoolisées...)
- Vente de boisson alcoolisées_ sur place et à emporter
- Terrasses
- Déclarations de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale (DAOA)
- Ouverture le dimanche
- TVA
- Enseigne et publicité
- Obligations et contrôles
- Hygiène
- RH et droit du travail
- Fraude et concurrence
- Litiges commerciaux- Médiateur de la consommation
- Fiscalité
- Incendie/ Sécurité/ Accessibilité
- Activités reglementées
- Certification Bio
- Notification? Certification? Ou rien?
- Processus de certification et controle
- Mixité des produits bios et nons bios
- Guide d’étiquetage et affichage BIO en épicerie
- Traçabilité
- Bio et nuisibles
- Restauration et mention de Bio
- Echanges de pratiques entre épiceries
- FOCUS ACTI_Epicerie
- Traçabilité
- Obligations relatives à la vente en vrac
- DLC et DLUO
- Vente déclassée et seuil de revente à perte
- Etiquetage et prix
- Metrologie- produits pré emballé et en vrac
- Vente en vrac - Bonnes pratiques
- Gestion de la perte
- Reconditionnement des produits service arrière
- FOCUS ACTI_Traiteur et restauration
- Affichages en restauration
- Formation nécessaire pour ouvrir son bar-restaurant
- Diffusion de la musique
- Exposition des boissons non alcoolisées
- Normes d'aménagement, de sécurité incendie, électrique
- Certification bio en restauration
- FOCUS ACTI_Vente en gros et B2B
- FOCUS ACTI_Brasserie
- Guides des bonnes pratiques des lieux de brassage
- Réglementation et démarches propres aux brasseries
- FOCUS ACTI_Boulangerie/ Patisserie
- FOCUS ACTI_ Commerce non sédentaire
Affichage obligatoire
En tant qu’employeur vous avez des obligations en termes d’affichage et de communication de certaines informations à vos salariés.
En cas de non-respect (constaté par l'inspection du travail) de vos obligations, vous vous exposez à des sanctions. Notamment à une amende pour défaut d'affichage, et en cas de récidive à une condamnation d'un an de prison et 37 500 € d'amende pour délit d'obstacle (article L8114-1 du Code du travail).
Les informations signalées par un astérisque* ne doivent pas ou plus être obligatoirement communiquées aux salariés par le biais dans affichage dans les locaux. L'obligation est désormais celle d'une communication apportant aux salariés des garanties équivalentes, par exemple via la diffusion sur le site intranet de l'entreprise, ou par courriel (cependant un affichage est toujours possible).
Pour la clientèle et les salarié·es
|
Type d'information |
Contenu |
|---|---|
|
Consignes de sécurité, d'incendie et avertissement de zone de danger |
- Consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010 |
|
Interdiction de fumer et de vapoter |
Depuis 2008, une signalisation apparente doit rappeler le principe d'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise. Celle-ci doit être apposée aux entrées des bâtiments et à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente. Un avertissement sanitaire doit être apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs si de tels espaces sont mis en place. Il y sera rappelé que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent y accéder. Les modèles de signalisation et d'avertissement sanitaire ont été déterminés par arrêté du 3 janvier 2007 du ministre chargé de la santé. Ils sont téléchargeables sur le site www.tabac.gouv.fr. |
|
Numéros d’urgence |
URGENCES : 112 SAMU : 15 POLICE : 17 POMPIERS : 18 SERVICE DE SECOURS POUR LES PERSONNES MAL-ENTENDANTES / SOURDES : 114 Centre Antipoison : 04 72 11 69 11 Inspection du Travail du Rhône : dépend du lieu d'exercice de l'activité Médecine du Travail : AST TEL : dépend du lieu d'exercice de l'activité LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS AU TRAVAIL (+ conditions de saisine du défenseur des droits) : 09 69 39 00 00 Pour chacune de ses missions, le Défenseur des droits est saisi directement par la personne physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection. Les personnes l’ayant saisi ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles ; La saisine peut s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures, les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit.
|
Pour les salarié·es
|
Type d'information |
Contenu |
|---|---|
|
|
Adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail compétent Conditions de communication aux salariés mises en œuvre par l'employeur communiquées au préalable à l'agent de contrôle de l'inspection du travail |
|
Service d'accueil téléphonique Défenseur des droits |
N° de téléphone |
|
Adresse et numéro de téléphone du médecin du travail |
|
|
|
Avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement Référence de la convention collective dont relève l'établissement et des accords applicables (précisions sur les conditions de leur consultation sur le lieu de travail) |
|
Horaires collectifs de travail |
Horaire de travail (début et fin) et durée du repos |
|
Repos hebdomadaire |
Jours et heures de repos collectifs (si le repos n'est pas donné le dimanche) |
|
|
- Période de prise des congés (2 mois avant le début des congés) |
|
Égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes* |
La réglementation relative à l'égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes. |
|
|
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent aussi communiquer l'adresse et le numéro de téléphone du référent harcèlement sexuel. |
|
Lutte contre la discrimination à l'embauche* |
Texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (informations devant les locaux ou à la porte où se fait l'embauche). |
|
Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) |
Conditions d'accès et de consultation du document. · inspection du travail et le nom de l'inspecteur compétent |
|
Convention collective applicable et accords collectif d’entreprise |
· Défenseur des droits. |
|
Travail temporaire* |
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent aussi communiquer l'adresse et le numéro de téléphone du référent harcèlement sexuel.
|
|
Registre unique du personnel |
Identité des salarié·e·s, informations sur la nature du poste, type de contrat |
|
Panneaux syndicaux |
· pour chaque section syndicale de l'entreprise · pour les membres du comité économique et social (CSE) (à partir de 11 salariés). |
|
Organisations syndicales |
Disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail. |
|
Rupture convention collective |
Décision de validation par l’administration. |
Plus d’infos sur le site du gouvernement
Affichages ou diffusions obligatoires en fonction des effectifs de l'entreprise :
|
Nombre de salariés |
Type d'information |
Contenu |
|---|---|---|
|
Entre 11 salariés et 49 salariés |
Élections des membres de la délégation du personnel (tous les 4 ans) * |
Procédure d'organisation de l'élection des délégués du personnel au comité social de l'entreprise |
|
Entre 11 salariés et 49 salariés |
Comité sociale et économique (CSE) |
Liste nominative des membres du CSE, indiquant leur emplacement habituel de travail et leur participation à une ou plusieurs commissions. |
|
À partir de 50 salariés |
Règles en matière d'hygiène, de sécurité, de sanctions, etc.
|
|
|
À partir de 50 salariés |
Information sur l'existence d'un accord et de son contenu |
|
|
À partir de 50 salariés |
Plan de sauvegarde de l'emploi |
· Décision de validation ou d'homologation par l'administration, ainsi que les voies de recours. |
Qui contacter en cas de besoin ?
Pour des questions sur l’affichage obligatoire, contactez le CCRS (service concurrence, consommation et répression des fraudes de la DGCCRF).
Il y a un contact par département, il suffit de modifier cette adresse avec le nom du département concerné : ddcspp@savoie.gouv.fr
Pour info (ou rappel) les contrôles peuvent être faits par :
-
les agents de la DGCCRF de niveau national (contrôle sur le poids affiché, les prix)
-
les agents de la métrologie légale (contrôle sur la conformité légale de la balance)
pole c : agents de la DGCCRF (ministère économie) + agents de la métrologie légale
ERP_Normes de sécurité et accessibilité
Normes accessibilité pour les ERP
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap.
Réglementation accueil du public en fonction de la catégorie d'ERP (généralement catégorie 5) : demande d'ouverture nécessaire auprès de la commune.
Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.
L'accès concerne tout type de handicap : moteur, visuel, auditif, mental...
Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
L'accessibilité des établissements et de leurs abords concerne :
-
- Les cheminements extérieurs
- Le stationnement des véhicules
- Les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments
- Les circulations à l'intérieur du bâtiment
- Les sanitaires ouverts au public
- Les portes et sas intérieurs et les sorties
- Les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés
Dérogations possibles dans les cas suivants :
-
- Impossibilité technique (ex: trottoir trop court pour mettre une rampe à max 10% de pentes)
- contraintes liées à la conservation du patrimoine (impossibilité de modifier la façade classé pour mettre des portes aux normes PMR)
- disproportion manifeste entre les améliorations apportées et les coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiments et de ses abords
- Impossibilité technique (ex: trottoir trop court pour mettre une rampe à max 10% de pentes)
Elles doivent être autorisées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité :
-
- au préfet de département,
- à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.
Dans le cas des ERP de catégorie 5, une simple attestation sur l'honneur suffit.
Pour tout travaux de modification intérieur ou du cheminement ou rachat de fond de commerce, il y a nécessité de faire une autorisation de travaux auprès de la mairie pour informer et déclarer (et si besoin accepter) des travaux pouvant impacter l'accessibilité.
Documents d'aide
Café, bar, restaurant: réussir son accessibilité: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ACCESSIBILITE_DES_HOTELS-2011.pdf
Notice d’accessibilité simplifié de la préfecture du Rhone (2023)
La réglementation de l’accessibilité des bâtiments est consultable sur un site internet dédié à l’adresse suivante : www.accessibilite-batiment.fr
L’unité « accessibilité» de la direction départementale des territoires peut être consultée pour tout complément d’information sur les règles d’accessibilité.
Tél : 04-78-62-50-50 (réponse de 14h à 16 h du lundi au vendredi)
Mail : ddt-sbda-access@rhone.gouv.fr
Fiche récapitulatif => https://nuage.grap.coop/s/24jys2edGmyfRD7
A quel catégorie ERP mon activité appartient?
Les ERP sont classifiés sous 5 catégories selon leur activité et leur capacité d’accueil (nombre maximum de personnes que l’établissement peut recevoir) :
|
Catégorie 1 |
+ 1 500 personnes |
|
Catégorie 2 |
701 à 1 500 personnes |
|
Catégorie 3 |
301 à 700 personnes |
|
Catégorie 4 |
- 300 personnes à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie |
|
Catégorie 5 |
Etablissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité. - 200 personnes et - 100 personnes (en étage ou sous sol) |
Des catégories de 1 à 4 l'effectif prend en compte le public + le personnel.
Pour la 5ème catégorie, seul le public est pris en compte.
L'ouverture d'un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s'imposent au moment de la construction et au cours de l'exploitation. La réglementation applicable en matière de sécurité varie en fonction du classement du bâtiment.
> dans Grap, toutes les activités entrent dans la catégorie 5
Liste des obligations de sécurité des ERP
La constructionet l'exploitation d'un ERP sont soumises à des obligations de sécurité contre l'incendie et la panique. Ces mesures ont pour but de protéger les personnes, de favoriser l'alerte et l'intervention des secours et de limiter le pertes matérielles.
Regles de base à respecter lors de la conception ou modification d'un ERP
Les constructeurs et propriétaires doivent respecter le règlement de sécurité des ERP et les règles d'accessibilité.
Les ERP sont conçus pour permettre les actions suivantes :
- Évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur mise à l'abri si celle-ci est nécessaire
- Intervention des secours
- Limitation de la propagation de l'incendie par des matériaux et des éléments adaptés
Pour l'application du règlement de sécurité, un ERP est classé à la fois par type selon son activité et par catégorie selon sa capacité d'accueil.
Les règles techniques s'appliquent notamment pour les points suivants :
- Aménagement et isolement des locaux entre eux
- Façade (1 ou plusieurs) en bordure de voie ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public et l'accès des pompiers
- Matériaux de construction et d'aménagement intérieur résistants au feu
- Distribution intérieure et compartimentage pour limiter la propagation du feu et des fumées
- Nombre et largeur des sorties, des éventuels espaces d'attente sécurisés et des dégagements intérieurs (proportionnels à la capacité d’accueil)
- Désenfumage
- Dispositifs d'alarme et d'avertissement, service de surveillance et moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques
- Interdiction de stocker, distribuer et employer des produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables (sauf disposition particulière du règlement de sécurité)
- Éclairage électrique obligatoire
- Éclairage de sécurité obligatoire
- Garantie de sécurité et de bon fonctionnement des ascenseurs et monte-charge, installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation
Quand une personne exerce une activité libérale (médecin, expert-comptable, kinésithérapeute ...) dans sa résidence familiale, le local n'est pas considéré comme un ERP. La réglementation de sécurité incendie imposée aux ERP ne s'applique pas.
Dans les autres cas, les locaux sont soumis à la réglementation des ERP de 5e catégorie.
Règles d'alarme et de sécurité incendie
L'ERP doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les mesures de sécurité et de prévention sont proportionnées à l'activité et au public pouvant être admis à l'intérieur de l'ERP.
Lorsqu'un même bâtiment abrite plusieurs activités, les mesures de prévention et de sauvegarde de sécurité de chaque activité s'appliquent à la partie du bâtiment qu'elle occupe.
Les ERP de 5ème catégorie
Dispositif d'extinction du feu
L'ERP a au moins 1 extincteur portatif pour 300 m² et au moins un par niveau. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par1 panneau.
Une tuyauterie fixe et rigide, appelée colonne sèche, est installée dans l'ERP dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres de la voie accessible aux engins des pompiers.
Personnel de l'ERP
Le personnel est formé sur la conduite à tenir en cas d'incendie.
Il est entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
Un membre du personnel au moins doit être présent en permanence lorsque l'ERP est ouvert au public.
Cette disposition ne s'applique pas aux ERP recevant moins de 20 personnes. Toutefois, elle s'applique quand il s'agit de locaux à sommeil (par exemple, hôtel, pension de famille).
Consignes
Les consignes de sécurité adaptées au différents types de handicap sont affichées bien en vue.
Elles doivent indiquer les informations suivantes :
- Numéro d'appel des sapeurs-pompiers
- Adresse du centre de secours le plus proche
- Dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre
Alarme
Tous les ERP sont équipés d'un système d'alarme.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas être confondu avec un autre signal sonore.
Le personnel de l'ERP est formé à le reconnaître. Des exercices périodiques d'évacuation complètent cette formation.
L'alarme générale est donnée par bâtiment si l'ERP en comporte plusieurs.
Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant.
Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
À savoir
Le détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf) n'est pas obligatoire dans les locaux professionnels. Cependant, il est obligatoire s'ils ont un usage mixte d'habitation.
De plus, un assureur peut exiger le Daaf pour certaines activités professionnelles (restaurant, cabinet libéral accueillant du public...).
Liaison avec les sapeurs-pompiers
La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée avec un téléphone fixe (DSL ou fibre optique) dans tous les ERP. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'ERP, cette liaison n'est pas exigée.
Faciliter l'action des sapeurs-pompiers
Lorsqu'un ERP est en étage ou en sous-sol, un plan schématique inaltérable est affiché à l'entrée.
Ce plan d'intervention doit au moins représenter le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage occupé par l'ERP.
Le plan indique les éléments suivants :
- Dégagements (porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...)
- Cloisonnements principaux
- Locaux techniques et autres locaux à risques particuliers non accessibles au public (locaux de stockage, logement du personnel...)
- Dispositifs et commandes de sécurité
- Organes de coupure des fluides et des sources d'énergie (eau, gaz, électricité, ventilation, climatisation...)
- Moyens d'extinction fixes et d'alarme
Les ERP situés même partiellement en sous-sol doivent permettre aux services de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques en tout point de l'ERP.
Règles d'aménagement et de travaux
Demandes d’autorisation
- Avant le début des travaux, un ERP doit faire une demande d’autorisation de travaux à la mairie
- Avant ouverture, l’ERP doit faire une demande d’autorisation d’ouveture à la mairie au minimum 1 mois avant ouverture. Les 2 demandes peuvent se faire en parallèle.
Voir site de l'administration française pour plus d’infos
Accessibilité (voir page Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées )
La largeur du cheminement doit être de 120 cm au minimum. 90 cm autorisé si rétrécissement ponctuel sur une très faible longueur. Les portes d'entrées > 90cm minimum.
Idéalement prévoir plus large pour permettre le passage facile d'objets encombrants. Une palette UE bien droite qui dépasse pas = 80 cm de large donc un minimum de 100 cm de large pour la porte c’est mieux (pourquoi pas avoir 2 battants pour ouvrir sur 110-120) .
Tout changement de direction perpendiculaire d’une largeur de minimum 120 centimètre doit s’enchaîner sur un cheminement d’au moins 90.
Avoir des espaces de retournement pour les fauteuil (140 cm), les caisses doiventt être accessible pour les fauteuils, idéalement hauteur des rayons
Plus d’infos sur le site Handinorme.
Ces règles dépendent aussi de la réglementation ERP incendie, qui dépend de la surface.de vente.
Sécurité:
Les ERP sont soumis à des règles concernant la conception et la construction des locaux qui doivent :
- être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en sécurité des occupants ;
- avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ;
- avoir des sorties (2 au minimum), et les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent, aménagés et répartis pour permettre l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes ;
- être composés de matériaux et d'éléments de construction présentant, face au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques ;
- Etre aménagés, notamment en ce qui concerne la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement, de façon à assurer une protection suffisante.
- L'éclairage de l'établissement doit être électrique.
- Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides inflammables soumis à autorisation ou enregistrement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public.
- Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Eclairage de sécurité
Extincteurs
EXCTINCTEURS
Article R4227-29 du code du travail
- au moins 1 extincteur portatif à eau pulvérisée (6 litres) pour une surface au sol de 200 à 300 m²
- au minimum un appareil par niveau,
Pour ce qui est du type d’extincteur, il faudra prévoir 1 extincteur à eau de 6 litres ou bien 1 extincteur à poudre de 6 kg ou encore 2 extincteurs CO² de 5kg.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Les documents obligatoires
- Un contrat de maintenance avec une société pour les extincteurs avec une vérification annuelle.
- Un registre de sécurité à tenir (document qui recense les contrôles- electricité, extincteur...)
- Affiche obligatoire: plan évacuation, réglement intérieur (facultatif)...
ÉVÉNÉMENTS PONCTUELS (fermetures tardives,...)
Lors d’événements ponctuels il est impératif de veiller au respect des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes au sein de l’établissement.
Lorsque les locaux sont utilisés pour une activité autre que celle autorisée, une autorisation doit être obtenue du maire et de la commission de sécurité compétente dans les 15 jours précédant la manifestation (article GN 6 du règlement de sécurité).
Défibrillateur?
OBLIGATION D’AVOIR UN DÉFIBRILLATEUR POUR LES ERP
Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6 (version en vigueur depuis le 1er septembre 2019)
> activités de Grap non concernées par l’obligation du défirbrillateur
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5."
Procédures d'autorisation de travaux
Lien vers le site du gouvernement: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31687
Marques, propriété intellectuelle et mentions légales
Marque
Il est fortement conseillé de déposer le nom de sa marque à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Sur ce lien, vous trouvez les étapes clés du dépôt de marque.
Pour le nom, il existe des critères à respecter et notamment se référer à la loi Evin qui réglemente la communication sur les produits alcoolisés.
Mentions légales
La loi pour la confiance dans l’économie numérique précise les informations que vous devez faire apparaître sur votre site internet.
Mentions complémentaire obligatoire: Médiateur de la consommation
Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel.
Le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).
Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (CGV et bons de commande).
Autres informations: https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires#
Mentions obligatoire et abusive
Des étiquetages incomplets et des dénominations imprécises
- Sur les étiquetages
Des manquements ont été relevés : absence d’indication ou de mise en évidence des allergènes, de dénomination légale, de l’adresse de l’exploitation alimentaire, des mentions dans le cadre de la vente à distance, des TAV au-delà de la tolérance réglementaire, manque de lisibilité sur l’étiquetage, etc. D’autres mentions étaient absentes sur certaines étiquettes comme le numéro du lot ou le message d’alerte sanitaire (phrase type ou logo « femme enceinte »).
- Sur les dénominations
Les dénominations légales des bières sont encadrées par le décret n°92-307 modifié. Les bières qui n’entrent pas dans les catégories listées par ce décret doivent être commercialisées sous un nom descriptif. Une bière était dénommée « bière aux cerises » alors que les fruits avaient été incorporés au-delà du seuil prévu par le décret.
La dénomination « bière » admet la présence d’épices naturelles et d’herbes aromatiques. Néanmoins, les ingrédients ajoutés ne doivent pas conférer au produit final leurs caractéristiques aromatiques et doivent obligatoirement figurer sur l’étiquetage du produit.
Mais si l’ajout de matière végétale apporte une saveur perceptible à la boisson, la dénomination du produit devient « bière à ».
Si la bière contient un ajout d’arôme, la dénomination « bière aromatisée à » doit être utilisée. Une bière contenait un arôme de framboise sous la dénomination « bière framboise».
S’agissant de la « bière de garde », pour être commercialisée sous cette dénomination, une période minimale de garde d'une durée de 21 jours doit être respectée. Deux brasseurs utilisaient ce terme à tort.
L’utilisation abusive de mentions valorisantes
- L’artisan brasseur doit se conformer à certaines obligations
Le terme « artisan » est une mention valorisante très appréciée des consommateurs. Certains producteurs nouveaux sur le marché peuvent être enclins à l’utiliser du fait de leurs méthodes de production ou des faibles volumes produits. Pour être qualifié d’artisan, le professionnel doit obligatoirement répondre aux critères imposés par la réglementation, comme être immatriculé au répertoire des métiers et répondre aux exigences de qualification ou d’expérience professionnelle.
- Des bières sont présentées à tort comme locales
Les qualificatifs se rapportant à un département ou une région sans autre précision de type « Bière normande » peuvent prêter à confusion sur l’origine des matières premières employées et laisser entendre que les ingrédients proviennent de Normandie.
Réglementation (enseigne, terrasse, vente de boissons alcoolisées...)
Vente de boisson alcoolisées_ sur place et à emporter
Toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées, à titre principal ou accessoire, doit posséder une licence.
Il peut s'agir d'un établissement de vente :
- sur place (café, bar, pub, discothèque, restaurant, hôtel-restaurant, bar-restaurant, chambre d'hôtes)
- ou à emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet).
À noter
Les débits de boissons temporaires (sur une foire, une fête locale, etc.) ne sont pas obligés d'avoir une licence. Une autorisation de la mairie suffit.
Les marchands ambulants (food-truck, camionnettes de restauration, camions pizza, etc.) peuvent vendre seulement des boissons avec un taux inférieur ou égal à 18° d'alcool (vin, bière, cidre, porto, poiré, etc. et boissons sans alcool). Il leur est interdit de vendre des alcools forts (whisky, vodka, rhum, pastis, etc.). Seule la petite licence à emporter les concerne.
Les licences en restauration
Quand les boissons alcoolisées accompagnent les repas, le restaurateur doit être titulaire d'une licence de restaurant (pour tous les alcools) ou d'une petite licence restaurant (pour seulement les vins, cidres et bières).
Si la vente d'alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d'une licence III ou IV. La licence restaurant ou la petite licence restaurant ne sont alors pas nécessaires.
Les gîtes et chambres d'hôtes qui souhaitent proposer une restauration le soir avec de l'alcool doivent posséder l'une de ces 2 licences : licence de restaurant ou petite licence restaurant. Cela ne s'applique pas à ceux proposant seulement le petit-déjeuner.
L'établissement qui possède une licence restaurant ou une licence III ou IV, peut vendre à emporter les boissons autorisées par sa licence.
Si l'établissement vend exclusivement des boissons à emporter (épicerie, vente en ligne), il doit être titulaire :
- soit de la petite licence à emporter, pour le cidre, le vin et la bière,
- soit de la licence à emporter, pour les alcools de plus de 18°.
Concernant les deux licences de vente à emporter (grande et petite), le permis d’exploitation n’est pas demandé. En effet, il est nécessaire uniquement lorsque la consommation d’alcool se fait sur place et non à emporter.
Les marchands de restauration ambulants comme les food trucks n'ont pas le droit de vendre des alcools de plus de 18°.
Pour la vente à emporter d'alcool entre 22h et 8h du matin, il faut être titulaire d'un permis d'exploitation.
Sur le bon de commande ou facture d'une vente à distance d'alcool, le vendeur doit écrire la mention "produit soumis à un droit d'accisesTaxe indirecte perçue sur la vente ou l'utilisation de certains produits : boissons alcoolisées, produits du tabac et produits énergétiques)" (en plus de la description des produits, de ses coordonnées et de celles de l'acheteur).
Les conditions pour demander une licence?
Nationalité
Il n'y a pas de condition de nationalité requise pour obtenir une licence de débit de boissons (restaurant ou bar).
Cependant, l'entrepreneur étranger en France doit respecter certaines règles.
Âge et dossier judiciaire
Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut remplir les 3 conditions suivantes :
- Être majeur ou mineur émancipé
- Ne pas être sous tutelle
- Ne pas avoir été condamné à certaines peines : les crimes de droit commun et de proxénétisme interdisent définitivement de posséder une licence. En revanche, pour les délits comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'interdiction de licence est supprimée au bout de 5 ans après la peine (sans récidive).
Comment obtenir une licence?
Pour obtenir une licence de débit de boissons ou de restaurant, il faut :
- Détenir un permis d'exploitation, délivré après une formation spécifique
- Effectuer une déclaration préalable d'ouverture (ou de mutationChangement de propriétaire ou de gérant ou de translationDéplacement de la licence d'alcool d'un local à un autre local dans la même commune)
- Recevoir le récépissé de déclaration prouvant la détention d'une licence
Quota par commune pour l'attribution d'une licence III
Une commune délivre un nombre limité de licences.
Les licences se demandent en mairie (dans la plupart des cas) après avoir acquis un permis d’exploitation
Il est interdit de délivrer une licence III (licence 3 appelée aussi licence restreinte) dans une commune où le total des établissements ayant une licence III et ceux ayant une licence IV dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants.
Il existe cependant des exceptions. Il est possible de déroger à cette limitation, dans les 2 cas suivants :
- Si l'installation a lieu dans une ville ou une commune touristique ayant une politique du tourisme, des hébergements conçus pour l'accueil de touristes et recevant une dotation de l'État dédiée au tourisme. Le nombre de débits de boissons autorisés est alors défini par décret.
- Lors du transfert d'un débit de boissons dans une autre commune, dans le cas où l'autorisation du transfert a été validée par le préfet.
Marché de la licence IV
Cette catégorie de licence s'obtient uniquement par un rachat avant de pouvoir faire un transfert, une mutation ou une translation. Elle fait donc l'objet de spéculation. On peut en trouver sur LeBonCoin ou bien les sites spécialisés.
Les trois façons de céder une licence d'exploitation dans les règles est de le faire avec la cession d'un fonds de commerce (mutation), de manière indépendante et dans un autre établissement de la même commune (translation) ou dans une autre commune (transfert).
Attention il y a des zones d'implantation possibles des licences et des zones impossibles = zones protégées.
Le transfert de la licence correspond au déplacement de l'établissement vers un autre local en dehors de la commune où il est situé. Il peut déménager à l'intérieur d'un même département, dans un département limitrophe ou ailleurs sous certaines conditions.
Dans le même département
Un débit de boissons peut déménager à l'intérieur du département où il est situé.
En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l'exploitant doit demander l'autorisation de transfert au préfet du département où il souhaite s'implanter.
Le préfet doit consulter le maire de la commune d'origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. La décision finale revient au préfet.
Le maire est décisionnaire final dans un seul cas : lors d'un transfert de licence IV dans une commune où il n'existe qu'un seul établissement de cette catégorie. Le transfert de la dernière licence 4 d'une commune était interdit avant aout 2015.
Dans un autre département
Un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe à celui dans lequel il se situe, mais alors cette licence ne peut pas faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département durant une période de 8 ans.
Des transferts sont exceptionnellement autorisés au-delà du département pour certains établissements touristiques comme des hôtels classés ou des terrains de camping.
Autorisation ou refus de transfert
En cas de refus, cette décision prend la forme d'un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, les délais et les voies de recours.
En l'absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.
Un débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé. Il ne peut plus être transféré de lieu.
Toutefois, ce délai est suspendu en cas de liquidation judiciaire ou de fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
Permis d'exploitation
Le permis d'exploitation correspond à une attestation qui prouve que le futur exploitant a suivi une formation spécifique obligatoire.
Il est délivré par l'organisme agréé qui réalise cette formation.
Cette formation est indispensable pour ouvrir le droit à l'exploitation d'un débit de boissons alcoolisées.
La formation porte sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection de mineurs, la répression de l'ivresse publique, la lutte contre le bruit. Elle forme également le futur exploitant à la législation des stupéfiants et aux principes de la responsabilité civile et pénale.
La liste des organismes agréés diffère selon que la vente se fait sur place ou à emporter la nuit.
Le permis d'exploitation est valable 10 ans. Il est ensuite renouvelable en effectuant une nouvelle formation de 6 heures.
Le permis est constitué d'un formulaire rempli par l'organisme de formation et délivré au futur exploitant, à condition qu'il ait suivi entièrement la formation.
Permis d'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant
Déclaration préalable en mairie et récépissé
Pour recevoir la licence, vous devez faire une déclaration d'ouverture (ou de mutation/ Changement de propriétaire ou de gérant ou de translation/ Déplacement de la licence d'alcool d'un local à un autre local dans la même commune) du restaurant ou du débit de boissons.
Vous remplissez pour cela le formulaire ci-dessous. Vous le transmettez à la mairie ou à la préfecture avec les documents nécessaires (justificatifs d'identité et permis d'exploitation valide).
Cette déclaration administrative doit être effectuée au moins 15 jours avant l'ouverture, la mutation ou la translation du débit.
Dans le cas d'une mutation à la suite d'un décès, le délai de déclaration est d'1 mois après le changement d'exploitant.
Après avoir rempli et transmis cette déclaration, l'exploitant reçoit un récépissé qui constitue la preuve qu'il possède une licence.
Ce récépissé ne donne pas le droit d'exploiter un débit de boisson (c'est le rôle du permis d'exploitation).
Il ne prouve pas non plus la validité du titre de propriétaire ou de gérant (il s'agit des identifiants et documents prouvant l'immatriculation de l'entreprise au RNE : RNE : Registre national des entreprises).
Validiter de la licence
La licence, contrairement au permis d'exploitation, a une durée de validité indéterminée.
Cependant, en cas d'arrêt d'exploitation de l'établissement, la licence est annulée au bout de 5 ans.
Cette durée de 5 ans est valable si l'arrêt fait suite à une volonté de l'exploitant.
En cas de fermeture pour liquidation judiciaire, la licence est annulée automatiquement à la fin de la procédure.
Affichage obligatoire
La règlementation en vigueur impose certains affichages obligatoires :
- La licence doit être affiché à l'extérieur du lieu de vente.
- L'affichage obligatoire concernant a consommation d’alcool et l’ivresse publique doit être visible à l’extérieur du bar..
- Les affiches de protection des mineurs doivent être visibles à l’entrée de l’établissement et à proximité du bar ou du comptoir.
Vous ne devez pas vendre ou offrir gratuitement de l'alcool à un mineur.
Si vous le faites, vous risquez une amende de 7 500 € et une interdiction d'exploiter votre licence pendant 1 an.
Vous devez exiger du client qu'il prouve sa majorité au moyen d'un justificatif.
Il est interdit de laisser entrer un jeune de moins de 16 ans non accompagné par un adulte.
Vous ne pouvez pas employer ou prendre en stage un mineur, sauf si c'est un membre de la famille (jusqu'aux cousins éloignés, dits cousins germains).
Il n'est pas possible d'ouvrir un bar partout où on le souhaite. Il existe des zones où il est interdit de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place (licences III et IV). Il existe aussi des quotas qui limitent le nombre de débits de boissons par commune.
Zones protégées
Les zones d'interdiction concernent ce qu'on appelle les débits de boissons alcoolisées.
Ce sont les établissements de vente d'alcool à consommer sur place.
Seuls ceux qui possèdent une licence III ou une licence IV sont concernés.
Il s'agit donc principalement des bars et des cafés.
Il existe des lieux dans l'espace public où il est interdit d'ouvrir un débit d'alcool.
Ce sont des zones créées pour protéger la santé des mineurs et des consommateurs.
Il s'agit de périmètres déterminés autour des établissements suivants (à Lyon 150m en porte à porte):
- Stade, terrain de sport privé ou public, piscine
- Hôpital, clinique, centre médical, centre de soins ou d'accueil en addictologie
- Centre de loisirs ou d'hébergement collectif pour la jeunesse,
- Établissement d'enseignement (publics et privés, de tout degré scolaire de l'école à l'université) ou de formation
Les restaurants qui vendent de l'alcool uniquement servi au cours des repas ne sont pas concernés par ces interdictions.
Ces zones sont protégées par arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral détermine l'étendue de la zone de protection et la distance d'interdiction définie à partir de l'établissement « protégé ».
En savoir plus: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F22384
Le guide juridique de la vente: https://www.syndicat-cotesdurhone.com/upload/article/file/guideventevf19042021-607e72f564358.pdf
Terrasses
Si vous souhaitez occuper une partie de l'espace public (trottoirs, places) pour votre bar ou restaurant, vous devez en demander l'autorisation (en mairie ou préfecture). Il s'agit d'une AOT : AOT : Autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Vous avez le choix entre 2 types d'autorisations :
- permis de stationnement (terrasse ouverte, food-truck) ou
- permis de voirie (terrasse fermée).
Vous n'avez pas le droit d'installer un système de chauffage ou de climatisation. Toutefois, l'installation est possible s'il s'agit d'une terrasse fermée par des murs et hermétique à l'air.
Déclarations de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale (DAOA)
Ce formulaire permet à tout établissement qui produit ou commercialise des denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale d'effectuer la déclaration obligatoire avant ouverture.
- Vous devez faire une déclaration pour toute activité manipulant des denrées d'origine animale destinées à des consommateurs.
Cette obligation concerne les professionnels qui vendent ou remettent directement les denrées aux consommateurs.
Elle doit être adressée à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP).
Elle doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.
Cette déclaration est obligatoire pour permettre au service Hygiène et sécurité alimentaire de la DDPP de programmer les visites de contrôle sanitaire.
Elle est aussi obligatoire à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité.
Le formulaire doit être téléchargé, imprimé et rempli.
La demande doit être adressée à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP).
Si l'activité consiste à vendre des denrées d'origine animale à d'autres professionnels, vous devez demander un agrément.
Agrément
Comment savoir si je dois demander l'agrément?
En répondant à ces questions:
- J'utilise dans produits d'origine animale? (si uniquement végétal: RAS)
- Je livre des professionnels qui font de la revente? (Si uniquement B to C: RAS)
Si l'acivité répond deux "OUI", elle doit demander un agrément ou une dérogation d'agrément.
Pour bénéficier de la derogation, il faut rester dans ces cadres:
Tout transformateur qui manipule des denrée animale doit faire (par CERFA 13984-05) une déclaration d'ouverture de labo
- livrer des clients à moins de 80kms du site de production et ne pas dépasser les quantités limites (en poids et en rapport à la totalité de votre prod)
Tout transformateur qui manipule des denrée animale doit faire (par CERFA 13984-05) une déclaration d'ouverture de labo
Lien Nuage: https://nuage.grap.coop/s/geZzEqFkQZeEZe4
Ouverture le dimanche
Le dimanche est destiné au repos hebdomadaire des salariés (repos dominical). L'ouverture d'un commerce le dimanche est donc, en principe, interdite. Toutefois, certaines autorisations vous permettent d'ouvrir votre commerce le dimanche. Ces autorisations alternatives dépendent de votre nombre de salariés, de la nature de votre commerce ou de votre localisation.
Un commerce peut ouvrir le dimanche si l'emploi de salariés n'est pas requis. Vous pouvez ouvrir sans autorisation préalable et sans restriction d'horaires, peu importe la nature de votre commerce (alimentaire, non alimentaire, de détail, etc.).
Cependant, un arrêté préfectoral peut interdire l'ouverture de certains commerces le dimanche. Renseignez-vous auprès de la préfecture de votre département.
Les commerces de détail alimentaire sont autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures.
Dans les établissements avec une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 %.
Les hôtels, cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir le dimanche, sans restriction d'horaires, pour répondre aux besoins du public.
Le contrat de travail du salarié doit mentionner l'obligation de travailler les dimanches
Vous pouvez ouvrir le dimanche, sans restriction d'horaires, si votre commerce est situé dans l'une des zones suivantes :
- Zone touristique internationale (ZTI)
- Zone touristique simple
- Grande gare
- Zone commerciale
Attention
Dans ces zones, les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche. En revanche, ils doivent fermer à partir de 13 heures.
TVA
Ventes en boutique :
- A consommer sur place = TVA à 10% (sauf alcool 20% et thé/café à 5,5%)
- A emporter = TVA à 5,5% (sauf alcool 20%), la philosophie c'est que le plat est emballé et peut être conservé un minimum ( Cf exception point d'après). Attention, cela veut dire que le client retire lui même son menu, il n'y a donc pas de livraison !
Ventes en livraison (via les internet par exemple) :
- Dès qu'il y a une livraison, cela n'est plus de la "vente de bien", mais de "prestation de service" = TVA à 10% (y compris les frais de livraisons, sauf si ces frais sont facturés séparément = 20%).
- Exception cependant pour ce qui est conditionné et peut être conservé = TVA à 5,5% (quid de la livraison?) cf doc impots "En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ; ils bénéficient du taux réduit de 5,5 %." Cela ne concerne donc pas les plateaux repas !
Prestations traiteurs réalisées sur place :
- De ce coté, pas de grosse MAJ sur la bouffe = TVA à 10%
- la grosse nouveauté concerne les frais annexes qui peuvent être assujettis à 10% !précision des impôts "outre la fourniture de nourriture préparée ou non et de boissons (à l'exclusion des boissons alcooliques, se reporter au I-B § 70 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10), un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène, etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place. Le taux réduit de 10 % s’applique sur l’ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement."
- attention : restent à 20% : Mises à disposition d'hôtesses, personnel de vestiaire, voiturier, chauffeur, videurs, DJ, gogo danseur, dresseurs de poney, équipe interne du GRAP (sur place ou à emporter...).
Attention : si vous avez un doute, ne changez rien ! Vous pouvez vous référer aux documents des impôts car chaque produit peut être concerné par une exception...
Par exemple la TVA au taux normal 20% pour : confiseries, produits composés contenant du chocolat, margarines et au caviar...
plus d'info : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/705-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-BASE-10-20-10-20190807
Enseigne et publicité
Une enseigne commerciale permet aux clients d'identifier le local d'exploitation d'une entreprise (ex : une boutique). L'enseigne doit respecter des règles d'emplacement, de dimensions et d'éclairage nocturne. Son installation requiert également une autorisation préalable dans certains cas. Par ailleurs, les enseignes temporaires qui signalent des évènements particuliers se voient appliquer des règles différentes.
Une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s'y exerce. Autrement dit, l'enseigne commerciale est un signe extérieur visible et apposé sur un établissement (ex : nom de l'entreprise, logo ou les deux, etc.).
Elle permet de signaler la présence du local d'exploitation et d'en préciser l'objet (restaurant, tabac, hôtel, vêtements, optique, etc.).
L’enseigne est un élément du fonds de commerceEnsemble des éléments nécessaires à l'exercice de l'activité : clientèle, enseigne, nom commercial, matériels et équipements, droit au bail (local commercial), droits de propriété, contrats de travail et d'assurance en cours. au même titre que la clientèle.
L'enseigne commerciale n'est pas obligatoire pour l'entreprise, contrairement à la dénomination/raison sociale.
Emplacement et dimensions de l'enseigne => réglementation => https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F24357
Enseignes nécessitant une autorisation préalable
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation administrative préalable lorsqu'elle est réalisée dans l'un des lieux suivants :
- Dans les communes couvertes par un règlement local de publicité (RLP)
- Sur les arbres
- Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
- Sur les monuments naturels et dans les sites classés ou inscrits
- À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque
- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables
- Dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles
- Dans les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciales
À noter
Une autorisation administrative préalable est également requise pour l'installation des enseignes à faisceaux laser.
Enseigne et syndic de copropriétés: lien doc nuage: https://nuage.grap.coop/s/f2bp5RcFGkHFH48
Obligations et contrôles
Hygiène
Contrôle réalisé par la Direction départementale pour la protection des populations (DDPP) et DDCSPP
Ces 2 directions vérifient en particulier les points suivants :
- Les dates limites de consommation ne sont pas dépassées
- Il n'y a pas de congélations illicites ou avec des matériels inadaptés
- Les règles de température sont respectées et il y a des thermomètres dans les réfrigérateurs ou chambres froides
- Les installations sanitaires sont respectées
- La méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments permettent à l'établissement d'assurer le transport, la conservation et l'utilisation jusqu'à la remise au consommateur final des denrées alimentaires dans les conditions sanitaires requises
- Il n'y a pas de fausse mention valorisante sur l'origine des produits (exemples : régional, fermier), le type de fabrication (exemples : maison, du chef) ou sur la nature même des produits (exemple : jambon pour de l'épaule)
Les bases d'une bonne hygiène
Local, matériel, équipement
Local, matériel, équipement
Vous devez agencer vos locaux en respectant les pratiques suivantes :
- Séparer les zones de travail sales (plonge, poubelles) et les zones propres (élaboration et stockage)
- Agencer les locaux de manière à faciliter l'entretien régulier
- Ne pas avoir à traverser les cuisines ou le commerce pour accéder au local poubelle
- Prévoir des sanitaires pour le personnel et des sanitaires pour les clients
- Les sanitaires ne doivent pas donner sur les locaux où sont cuisinés ou stockés les aliments
- Stocker les produits de nettoyage séparément (placard, local)
- En cas de vestiaires, les situer à proximité du poste de travail des employés
À noter
Si au moins 25 salariés déjeunent sur le lieu de travail, un local de restauration doit être mis à leur disposition, avec tables et sièges en quantité suffisante, robinet d'eau potable et frigo.
Matériel
Les obligations concernant le matériel sont les suivantes :
- Un bac à graisse est obligatoire et de fait, un contrat de traitement des huiles.
- Le matériel doit porter l'avis de conformité LERPAC ou NF hygiène alimentaire.
- Il faut privilégier les ustensiles et matériels en inox ou en émail.
- Il faut privilégier le séchage des mains avec du papier jetable (les torchons sont sources à microbes).
- Les poubelles doivent être fermées avec un couvercle et s'ouvrir avec une pédale.
Les ustensiles et matériel en bois brut sont interdits.
Équipement
Votre commerce doit être muni des équipements suivants :
- Système de ventilation qui ne mélange pas l'air des zones propres et celui des zones sales
- Sanitaires avec cuvette et chasse d'eau, lavabo et savon
- En cuisine, des lavabos différents pour les mains et pour les légumes
- Lavabos avec commande non-manuelle (avec détecteur de présence ou commande par la jambe ou le pied)
- Sèche-mains soit avec air pulsé, soit avec papier jetable
- Syphon de sol pour évacuer les eaux de lavage
- Éclairage suffisant
- Chambre froide avec thermomètre et régulation des températures
- Vestiaire pour les employés si le travail nécessite une tenue spécifique
Règles d'usage du matériel
Vous devez respecter les pratiques suivantes liées au matériel :
- Laver les plans de travail et les ustensiles à chaque service
- Ne pas poser les marchandises alimentaires à même le sol
- Ne pas poser d'objet personnel sur les plans de travail (exemple : téléphone)
- Utiliser des pinces pour le service d'aliments en vrac aux clients
Stockage et conservation des aliments
Chaîne du chaud et du froid
La chaîne du froid (conservation entre 0° et 3°) ne doit jamais être rompue.
La température dans les frigos et les chambres froides doit être contrôlée en permanence.
Le respect de la chaîne du chaud s'impose également : pour la cuisson, les aliments doivent atteindre rapidement 63°. Cette température doit être maintenue stable pendant la cuisson.
Le refroidissement doit se faire le plus rapidement possible pour atteindre la température de 3°.
Après refroidissement, les aliments doivent être mis au frigo dès que possible.
Les matières premières et les produits transformés doivent être conservés dans des frigos différents.
Emballage
Les matériaux d'emballage doivent être désinfectés.
Les matières premières doivent être conservées dans des récipients hermétiques.
Congélation
Les pratiques suivantes sont interdites :
- Recongeler un produit déjà décongelé une fois
- Décongeler un produit à l'air libre (il faut le décongeler au frigo)
- Congeler une matière première, des restes (en restauration), des produits préemballés à conserver à température positive
À noter
Les produits venant directement de l'abattoir et les produits frais de la pêche peuvent être congelés.
Lien dossier nuage: https://nuage.grap.coop/s/t8YSnYKnnjdNNDg
Eau et déchets
Eau
L'alimentation en eau potable doit être en quantité suffisante.
L'eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable, ni pouvoir refluer dans ces systèmes.
La glace qui entre en contact avec les denrées alimentaires doit être fabriquée à partir d'eau potable.
Si la glace est destinée à réfrigérer les produits de la mer (entiers), elle doit être fabriquée à partir d'eau propre.
La vapeur d'eau pour cuire les aliments doit être issue d'eau propre.
Déchets
Il est interdit de détruire des invendus alimentaires. Ils doivent être valorisés. La réglementation est expliquée dans la fiche dédiée à la gestion des invendus.
Les déchets alimentaires doivent être triés à la source en tant que biodéchets.
Les entreprises de la restauration et les commerces alimentaires sont soumis à la réglementation générale sur la gestion des déchets des entreprises.
- Les déchets alimentaires ne doivent pas s'accumuler.
- Les poubelles doivent être vidées très régulièrement.
- Elles doivent comporter un couvercle et s'ouvrir avec une pédale.
- Elles doivent être lavées régulièrement.
- Le local à poubelles doit être indépendant du reste du magasin.
- Le personnel ne doit pas traverser les cuisines ou la salle de service pour aller au local à poubelles.
- Le personnel doit porter un équipement adapté (bottes de sécurité, gants) pour s'y rendre.
- Les huiles de fritures doivent être collectées par un organisme agréé.
HACCP , avoir ou ne pas avoir la formation
Hygiène alimentaire et du personnel
La formation HACCP et le « paquet hygiène »
Les personnes manipulant des denrées alimentaires doivent être encadrées et doivent disposer d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle.
Cette formation est souvent appelée formation HACCP.
Cette obligation est instaurée par la règlementation européenne encadrant l'hygiène alimentaire appelée « Paquet hygiène ».
Elle s'adresse à toute la filière agroalimentaire.
L'appellation HACCP signifie en anglais Hazard Analysis Critical Control Point. Il s'agit d'une méthode qui permet de prévenir et d'identifier les dangers liés aux pratiques d'hygiène alimentaire.
Toute personne manipulant des denrées alimentaires doit avoir suivi cette formation.
La formation HACCP peut être dispensée soit par un organisme de formation, soit par l’établissement lui-même.
Elle ne fait l’objet d’aucune exigence de contenu ou de durée.
À savoir
Une entreprise peut organiser elle-même la formation aux bonnes pratiques d'hygiène de ses salariés (via la diffusion d'instructions, d'échanges de pratiques...). Le recours à un prestataire extérieur n'est pas obligatoire.
Pour vous aider, il est recommandé de consulter un guide des bonnes pratiques d'hygiène (GBPH), validé par le ministère chargé de l'agriculture, en vigueur dans votre secteur d'activité. Il est élaboré par des professionnels de votre branche.
Consulter un guide de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH)
France Travail (anciennement Pôle Emploi) peut vous aider à trouver un prestataire effectuant cette formation :
Où trouver ma formation HACCP hygiène alimentaire
Hygiène du personnel
Toute personne travaillant en contact avec des aliments doit respecter les pratiques suivantes :
- Porter des vêtements propres
- Porter une coiffe
- Porter des gants lors de la préparation ou du service des aliments
- Jeter et changer souvent de gants
- Se laver les mains est obligatoire dans les cas suivants :
- Reprise du travail
- Sortie des sanitaires
- Après manipulation des déchets
- Après manipulation de matières premières
- Avant manipulation de produits laitiers (mayonnaise, beurre, fromage, crème fraîche, etc.)
Attention
Un employé malade (grippe ou gastro-entérite) ou blessé avec une plaie n'est pas autorisé à manipuler des denrées alimentaires.
Obligation de formation et restauration commerciale
Uniquement obligatoire dans la restauration commercial mais c'est un plus et un gage de bonne foi en cas de contrôle d'avoir suivi une telle formation.
La formation aux règles d'hygiène alimentaire est obligatoire dans les établissements de restauration commerciale. Il suffit qu'une seule des personnes de l'établissement ait suivi la formation.
La formation dure 14 heures minimum. Elle doit comporter 2 heures minimum en présentiel pour chaque séquence de 7 heures. Cette présence est indispensable notamment pour la manipulation de matériel.
Son coût varie entre 200 € et 500 € (selon les tarifs constatés sur le marché).
Il n'y a pas de date limite de validité de cette formation ni d'obligation de renouvellement.
Établissements concernés par cette obligation de formation
Les établissements de restauration commerciale concernés par cette obligation sont les suivants :
- Restauration traditionnelle : activité de restauration avec un service à table
- Cafétérias et autres libres services : une cafétéria est un lieu de restauration où il y a peu ou pas de service à table. Le consommateur se sert généralement comme dans un libre-service, à l'aide de plateaux individuels
- Restauration rapide et vente à emporter : établissement proposant la vente au comptoir d'aliments et de boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur éventaire et marché (y compris food-truck et camionnette).
La plupart des diplômes du secteur de la cuisine et de la restauration inclut automatiquement cette formation.
Activités non concernées par l'obligation de formation à l'hygiène alimentaire dans la restauration commerciale
Les activités et établissements suivants peuvent se dispenser d'effectuer cette formation :
- Hôtel servant uniquement des petits déjeuners
- Traiteur
- Rayon traiteur des grandes et moyennes surfaces
- Métier de bouche (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, poissonniers) proposant à la vente des plats cuisinés, sandwiches, salades
- « Point chaud » des magasins équipés de quelques tables « mange-debout »
- « Chef cuisinier » préparant des repas au domicile de particuliers
- Table d'hôte répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
- Constitue un complément de l'activité d'hébergement
- Propose un seul menu et une cuisine de qualité composée d'ingrédients du terroir
- Service du repas à la table familiale
- Offre une capacité d'accueil limitée à celle de l'hébergement
Si ces critères ne sont pas tous réunis, il s'agit alors d'un restaurant (et non d'une table d'hôte) qui doit respecter l'obligation de formation « hygiène alimentaire en établissement de restauration commerciale ».
Cette formation est facultative pour un professionnel qui peut justifier d'au moins 3 ans d'activité dans le secteur alimentaire en tant que gestionnaire ou exploitant.
Les 4 dangers à connaitre pour éviter le risque
Biologique
Vient de la présence de micro organismes, toxines ou agent pathogènes (bactérie, virus, moisissures)
La plupart sont détruites ou inactivés par la cuisson (les bactéries se multiplient très bien entre 10°C et 63°C)
Pour éviter ce danger une bonne gestion du stockage et de la conservation des aliments:
- Absence de nutriments
- Températures basses et élveées
- Sécheresse
- Acidité, sucre, sel
- Absence d'oxygène
Les facteurs de développement
- Humidité
- Température ambiante
- Nourriture
- Oxygène
- Temps
Suivi : Controle et enregistrement des températures (à reception, stockage, vente)
Les fromages au lait cru sont déconseillés au enfants de moins de 5 ans qui ne savent pas bien se défendre vis à vis des infections.
Chimique
Le danger chimique est lié à des contaminants:
- pouvant être naturellement présents dans les aliments (allergènes, mycotoxines...)
- ajoutés lors d'une étape du processus de production( pesticides, antibiotiques, plomb, contaminants provenant de l'emballage, résidus de produits de nettoyage...)
Pour limiter les risques d'occurence:
- Etre en règle, connaitre et détenir les certificats d'alimentarité de tous les ustensiles au contact des produits (ex: planches à découper)
- Les fiches de données de sécurité de produits de nettoyage
- Le sproduits de nettoyage doivent être stockés dans une armoire séparée.
- Bien rincer le matériel
- Tester régulièrement les huiles de fritures afin de garantir la qualité.
Physique
Danger lié à la présence de corps étranger dans les aliments (bout de verre, pansements, insectes...)
Son apparition est liée à de mauvaises pratiques au cours d'une ou plusieurs étapes de la chaine alimentaire.
Pour éviter:
- Analyse des pratiques
- Respect des règles d'hygiene du personnel
- Plan de lutte contre les nuisibles
Allergène
Risque de réaction allergique grave.
Bien indiqué sur les étiquettes les allergènes mais également dans le magasin pour prévenir de la volatilité de certains allergènes.
Concernant l'information sur la présence d'allergènes, le décret d'application entré en vigueur en 2015 précise :
- Pour les denrées préemballées, la liste des allergènes doit être indiquée sur l’étiquetage.
- Pour les denrées non préemballées (servies par les restaurants, traiteurs rayons à la coupe des hypermarchés et supermarchés...), l’indication de la présence d’allergènes se fait obligatoirement par écrit, sans que le consommateur n’ait à en faire la demande.
- Pour les produits en vue d’une consommation immédiate, l’information doit être signalée à proximité immédiate de l’aliment (ex. : vitrines...), de façon à ce que le consommateur n’ait aucun doute sur le produit concerné.
- Pour la consommation au sein d’un établissement de restauration ou cantine, les professionnels devront tenir à jour un document écrit sur la présence d’allergènes dans les plats proposés. Ce document devra être accessible pour le consommateur à sa demande, le choix de présentation étant laissé à l’appréciation des professionnels.
Une information sur la présence d'ingrédients allergènes dans les plats et boissons servis doit être donnée par écrit au consommateur :
- Soit en mentionnant clairement cette information sur la carte
- Soit en indiquant où il peut consulter cette information dans l'établissement (par exemple sous forme de tableau affiché au comptoir ou de cahier tenu à la disposition des clients)
La livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration doit être accompagnée d'un document portant l'information sur la présence d'allergènes.
14 allergènes sont concernés :
- Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales
- Crustacés et produits à base de crustacés
- Œufs et produits à base d’œufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Arachides et produits à base d’arachides
- Soja et produits à base de soja
- Lait et produits à base de lait
- Fruits à coque et produits à base de ces fruits
- Céleri et produits à base de céleri
- Moutarde et produits à base de moutarde
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
- Anhydride sulfureux et sulfites
- Lupin et produits à base de lupin
- Mollusques et produits à base de mollusques.
Pour assurer la lisibilité de l'étiquetage, le règlement européen INCO impose que les caractères soient d'une taille égale ou supérieure :
- à 0,9 mm dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm²,
- à 1,2 mm dans les autres cas.
Cette taille concerne le corps du texte.
Obligations et documents contrôles
Les obligations
-
- De résultats ... mais il faut pouvoir prouver qu'on met tout en œuvre, via notamment les feuilles d'enregistrement
- De mise en place de procédures basées sur les principes de l'HACCP en s'appuyant sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène
- De formation d'au moins une personne dans l'équipe à l'HACCP ou au guide de bonnes pratiques d'hygiène du secteur concerné (obligatoire en restauration). Aucune formation n'est obligatoire en épicerie, il s'agit de recommandation !
Nous recommandons que la majorité des personnes de l'équipe aient suivi une formation HACCP : cela permet de sensibiliser tout le monde aux enjeux de l'hygiène et évite qu'une personne aie un rôle de "gendarme" dans l'équipe
Attention à la transmission d'infos dans les transitions entre personnes dans une équipe : formaliser les choses permet de les pérenniser et de ne pas remettre en question les bonnes pratiques
Définir une procédure/ consigne
C'est l'ensemble des règles propres à une activité.
Contient:
- Objectifs à atteindre
- Moyens de réalisation
- Action en cas de non conformité
Les procedures peuvent faire l'objet de documents intégrés dans le PMS. On parle alors de procédure écrite ou de procédure documentée.
Elles peuvent être écrites ou orales.
Autocontrole
Tout examen vérification, prélèvement ou tout autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un exploitant afin de s'assurer par eux mêmes du respect des exigence.
Enregistrement des résultats des auto contrôles
On retrouve:
- Contrôles à réceptions,
- Vérification du nettoyage
- Enregistrements des T°C
- Suivi de la maintenance
- Analyse sur les produits
- Suivi de la lutte contre les nuisibles
Non conformité et actions correctives
Action visant à éliminer la cause d'une non conformité ou d'une situation indésirables et l'enregistrement des actions correctives prises.
Plan de maitrise sanitaire (PMS): Les Grands Principes
Outil permettant d'atteindre les objectifs de sécurité sanitaire des aliments fixé par la réglementation.
Il décrit les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire des productions vis à vis des dangers biologiques, physiques, chimiques.
Il comprend :
-
- Les bonnes pratiques d'hygiène du professionnel (BPH)
- Le plan HACCP
- Un système de traçabilité
Exemple d'organisation de PMS
-
- Nettoyage
- contrôle à réception
- enregistrement des températures
- hygiène du personnel
- suivi de la maintenance
Ecrire ce qu'on a fait et faire ce qu'on écrit + consigner les actions par écrit (nettoyage, températures....)
Le plan de maitrise sanitaire, ou PMS, est un ensemble de mesures préventives et d’autocontrôle ayant pour but de maintenir l’hygiène alimentaire. C’est un outil permettant le contrôle de l’environnement de la chaîne de production alimentaire pour garanti la sécurité des produit.
Il repose sur :
- un programme de prérequis, qui sont les premières mesures d’hygiène à mettre en place pour maintenir l’hygiène alimentaire. Ces prérequis sont détaillés dans l’annexe I du règlement CE n°852/2004 et l’annexe III du règlement CE n°853/2004 (pour les denrées animales ou d’origine animale) ;
- des procédures fondées sur les principes de le Système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise, en abrégé système HACCP (Hazard analysis critical control point) ;
- la communication et la traçabilité des produits.
Les programmes de prérequis (PRP) sont les mesures à mettre en œuvre en premier lieu avant même la mise en place d’une procédure fondée sur la méthode HACCP. Ils comprennent entre autres des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Les BPH sont des principes généraux d’hygiène qui s’appliquent à tous les paramètres de la production pouvant être à l’origine de contaminations (personnel, locaux, matériel, ingrédients). L’utilisation des bonnes pratiques d’hygiène permet ainsi de limiter le risque de contamination.
Les BPF concernent, quant à elles, le procédé en lui-même, par exemple l’utilisation de températures adéquates ou un bon dosage des ingrédients.
Afin de mettre en place les prérequis, les exploitants peuvent s’appuyer sur la méthode dite « des 5M » qui permet de répertorier les mesures à prendre en fonction de chaque facteur pouvant être source de contamination.

La méthode des 5 M
Le milieu
Le but est que les locaux ne soient pas source de contamination et que leur disposition et conception facilitent la procédure de nettoyage.
Les locaux doivent être propres et en bon état.
La disposition et les matériaux de ces locaux doivent être adaptés à la production de denrées alimentaires afin d’éviter les contaminations et de faciliter les procédures de nettoyage et de désinfection. Par exemple, des matériaux lisses doivent être utilisés pour les sols, murs et plafonds qui seront facilement nettoyables.
Les toilettes ne doivent pas être proches des zones de manipulation de denrées. Des lavabos pour le lavage des mains doivent être prévus et distincts de ceux utilisés pour les denrées alimentaires.
Les locaux doivent également disposer d’une ventilation dont les filtres seront changés facilement et régulièrement et d’un éclairage suffisant.
Les produits pour le nettoyage et la désinfection doivent être entreposés séparément des denrées alimentaires.
Enfin, la présence de vestiaire ou autres moyens permettant la séparation entre vêtement de ville et tenue de travail doit être prévue.
La main d’œuvre
Le personnel doit être en bonne santé et avoir reçu une formation en matière d’hygiène et principes de l’HACCP.
Le personnel doit porter une tenue adaptée (blouse, charlotte, masque) et réaliser des lavages des mains réguliers.
Le personnel peut être source de contamination : afin de limiter ce risque le personnel doit porter une tenue adaptée et différente de la tenue de ville (blouse, charlotte, masque) et réaliser des lavages de mains réguliers.
Le matériel
Le matériel doit être nettoyé et désinfecté de manière régulière.
Le lave-main doit être conçu de manière hygiénique, sans que l’opérateur ait à toucher la vanne d’ouverture d’eau (qui peut être source de contamination). Par exemple, il est possible d’avoir une commande au pied ou au genou.
Les méthodes
L’eau utilisée au cours de la production doit être propre et potable.
Afin de prévenir les risques de contamination croisée, il ne doit pas y avoir de contact entre les déchets et les denrées.
Un plan de nettoyage doit être prévu précisant la fréquence des interventions (qui doit être régulière), les produits à utiliser et le protocole d’utilisation.
Le professionnel doit mettre en place une gestion des stocks et l’agencement devrait se faire selon la méthode dite « premier entré - premier sorti » (PEPS ou FIFO).
Les exploitants doivent veiller à l’application de températures adaptées à leur production, et contrôler le dosage des ingrédients.
La matière
Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas accepter de denrées dont ils ne connaissent pas l’origine et la qualité hygiénique.
Lors de toutes les étapes, de la réception jusqu’à la vente, les conditions de stockage doivent être adaptées aux denrées (température, ventilation et propreté) afin de les protéger de toute éventuelle contamination.
La méthode HACCP se base sur l’analyse et la gestion du risque lié à une production. Elle comprend 7 principes et se réalise en 12 phases.
Les exploitants du secteur alimentaire, après étude des dangers liés à leur production, doivent mettre en place des procédures de maîtrise de ces mêmes dangers, ainsi qu’une surveillance à l’aide d’autocontrôles. Dans le cas où les autocontrôles révèlent un danger non acceptable, le professionnel doit mettre en œuvre des actions permettant d’éviter que le danger se reproduise, et dans le cas où les produits sont commercialisés, des procédures de retrait et rappel, en ayant averti les autorités compétentes.
Les 7 principes
Analyse des dangers : consiste à rassembler et évaluer les dangers et les conditions entrainant leur présence afin de déterminer ceux qui sont significatifs au niveau de la sécurité des aliments, et devront par conséquents être surveillés.
Identification des points critiques (CCP) : la maîtrise et le contrôle sont nécessaires pour surveiller ou éliminer un danger. Par exemple, les étapes d’élimination des micro-organismes via l’utilisation d’un traitement thermique est une étape clef, donc un point critique. Ces étapes peuvent être définies à l’aide d’un arbre de décisions disponible dans la communication de la commission européenne relative à la mise en place du plan de maitrise sanitaire du 30 juillet 2016.
Etablissement des limites critiques à ne pas dépasser pour un danger (distinction entre l’acceptable et l’inacceptable) : par exemple, dans le cas d’une contamination par un micro-organisme, la limite critique est la norme prévue par la réglementation. Lors d’une étape de cuisson, la limite critique est la température à atteindre, en dessous de cette température cible il y aura un risque.
Mise en place d’une procédure de surveillance des points critiques : dans l’exemple du cas précédant, pour une température de cuisson, la procédure de surveillance consistera à mesurer la température de la denrée à l’aide d’un thermomètre. Le professionnel doit être capable de prouver par des enregistrements les mesures d’autocontrôle qu’il réalise. Les autocontrôles permettent d’assurer et de s’assurer que le produit est sûr et sain.
Définition et mise en œuvre des actions correctives en cas de non-conformité (si le point critique n’est pas maîtrisé) : c’est-à-dire corriger la ou les causes de non-conformité. Dans le cas où la limite critique n’est pas respectée, le produit est alors dit « non-conforme » et le professionnel se doit de prendre des mesures pour corriger cela. Attention : ne pas confondre ce principe avec la correction qui est le simple fait de remettre les produits non-conformes en conformité.
Vérification de l’efficacité des actions correctives : le professionnel doit s’assurer que, suite aux actions réalisées, les denrées produites sont à nouveau conformes et ne dépassent pas la limite critique.
Mise en place d’un système documentaire précis et rigoureux afin de prouver la mise en oeuvre des mesures et l’enregistrement des actions menées. Ces documents doivent être conservés et pourront être demandé lors d’audits ou de contrôles officiels.
A noter : il est prévu une flexibilité pour petites entreprises. Le système HACCP n’est alors pas une obligation mais l’application de procédures basées sur l’HACCP est obligatoire afin de mettre en place des mesures de maîtrise adaptées à la nature et à la taille de l’établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire, après étude des danger liés à leur production doivent mettre en place des procédures de maitrise de ces mêmes dangers, ainsi qu'une surveillance à l'aide d’autocontrôle (suivi des températures, relevé des températures à l'arrivée, stockage des étiquettes et suivi de la traçabilité, suivi et gestion des nuisibles...)
Elaboration d'un Plan de Maitrise Sanitaire
Voir ce document type.
Réaliser une Description de la structure et des locaux.
0) Général
Déclaration aux autorités
DAOA
1) Personnel et hygiène des manipulations
Formation du personnel
Formation HACCP ou équivalent
Consignes et affichages d'hygiènes obligatoire
2) Organisation de la maintenance des locaux, des équipements et du matériel
Contrat de maintenance des équipements et preuves des interventions (CR, factures...)
Dans votre plan de maîtrise sanitaire, vous devez au minimum avoir un contrat pour les hottes aspirantes (si nécessaire), un pour la dératisation-désinsectisation, un pour le ramassage des huiles usagées (si nécessaire), un contrat de maintenance du matériel est conseillé, et enfin dans le cadre de vos autocontrôles, vous pouvez avoir un contrat avec un laboratoire pour les prélèvements de vos plats faits maison.
3) Nettoyage et désinfection
Plan de nettoyage
Un plan de nettoyage et de désinfection est essentiel pour garantir l'hygiène générale, maîtriser la contamination microbienne, maintenir le matériel et l'environnement en bon état, et se conformer à la législation en vigueur.
Un plan de nettoyage et désinfection est un document détaillé qui décrit les procédures de nettoyage pour chaque zone d’un établissement. Il comprend des informations sur les produits de nettoyage à utiliser, la fréquence de nettoyage, et les responsabilités du personnel.
-
- Identifier les zones à nettoyer : Cela peut inclure les cuisines, les salles de bains, les zones de préparation des aliments, etc.
- Choisir les produits de nettoyage appropriés : Certains produits sont plus efficaces pour certaines tâches que d’autres.
- Définir la fréquence de nettoyage : Certaines zones peuvent nécessiter un nettoyage quotidien, tandis que d’autres peuvent être nettoyées hebdomadairement.
- Attribuer les responsabilités : Assurez-vous que chaque membre de l’équipe sait quelles sont ses responsabilités en matière de nettoyage.
Enregistrement des taches
Fiches techniques des produits d'entretien
4) Plan de lutte conte les nuisibles
Contrat de dératisation/suivi des interventions
Plan des pièges
5) Suivi de températures
Fiche d'enregistrement des températures
Vous devez contrôler régulièrement la température de vos frigos et congélateurs pour garantir que la marchandise stockée à l’intérieur n’a pas subi de rupture de la chaîne du froid.
Il est conseillé de les contrôler avant chaque service. En pratique, c’est un des premiers contrôles que vous devez faire en prenant votre service. Le matin en arrivant, le soir en partant.
Faites le tour de vos enceintes froides pour vérifier qu’aucune n’a subi d’avarie. Vérifiez également que la marchandise à l’intérieur n’a pas subi de rupture de la chaine du froid.
Le contrôle de la température peut se faire grâce à un thermomètre indépendant stocké dans votre enceinte froide. Vous ne devez pas vous contenter de lire la température affichée sur votre enceinte froide. Ce relevé n’est pas assez fiable.
Il n’y a pas de durée minimum claire dans les textes de loi. Néanmoins, nous vous conseillons de les garder au moins 1 an, certains préconisent un minimum de 3 mois.
Certains contrôleurs de la DDP peuvent parfois demander de retrouver les documents de l’année passée pour vérifier que les contrôles sont bien réalisés.
Suivi des anomalies
Définir un protocole en cas de rupture de la chaine du froid et noter les différents problèmes et leur date.
Ex;
Que faire si un frigo est à 8 degrés au lieu de 3:
- le Désengorger
- Transferer les denrées dans un autre frigo.
- Nettoyer le radiateur (au moins 1 fois par an).
- Appeler le frigoriste.
- Si la'augmentation a été un peu longue, mettre les produits en DLC courte et en promo.
- Si l'augmentation a été unpeu TROP longue, jeté et passé en pertes.
Pour les congèl: test de la bouteille. On la remplit à moitié on la congèl, on la retourne et si on se rend compte que l'eau à changer de côté => il y a eu rupture de la congélation.
6) Procédures de traçabilité et de contrôle à reception
Archivage des retraits de lots
Fiche de réception des produits
Le contrôle de réception de marchandise en restauration comme dans tous les métiers de bouche est la première étape de la procédure de traçabilité alimentaire HACCP.
Au même titre que la traçabilité interne et la traçabilité aval, il participe à retracer le cheminement d’une denrée alimentaire depuis sa production jusqu’à l’assiette du consommateur.
La fiche de contrôle de réception de marchandise est un document formel où sont inscrites toutes les informations utiles attestant de la conformité, lors de leur réception, des denrées alimentaires périssables ou non et de tout autre élément utilisé en cuisine.
Elle accompagne les mesures d’hygiène mises en place dans votre établissement pour garantir la sécurité alimentaire de vos produits et alimenter votre système documentaire.
La fiche de contrôle de réception de marchandise fait partie des documents à présenter lors d’un audit ou contrôle sanitaire.
a première vérification consiste à s’assurer que les conditions de transport sont appropriées aux denrées livrées, puis à voir si elles correspondent au bon de commande (produits alimentaires, quantité, conditionnement, etc.). Et oui, si on vous livre du steak haché au lieu du steak, les DLC ne sont pas les mêmes !
Le contrôle des denrées se fait visuellement afin de vérifier l’intégrité des emballages et des aliments, puis par un relevé de température pour s’assurer du maintien de la chaîne du froid des aliments frais, réfrigérés, surgelés et à température ambiante.
Ces relevés doivent être réalisés à l’aide d’un thermomètre à sonde, dont la justesse est régulièrement vérifiée.
Il faut savoir que seule une mesure prise avec cet instrument peut être opposée en cas de litige.
Le contrôle porte également sur l’étiquetage des produits qui doit comporter :
-
- La dénomination du produit ;
- L’identification du fabricant (nom, adresse, etc.) et la marque d’identification des denrées animales ou incorporant des denrées animales ;
- La date limite de consommation (DLC), voire la date de durabilité minimale (DDM) ;
- Le numéro de lot ;
- La quantité par conditionnement.
À noter que des DLC trop proches peuvent être un motif de refus du produit. En effet, si vous recevez 20 kg de viande de boeuf à utiliser d’ici demain, il va falloir en produire du hachis parmentier 😋 !
La fiche de contrôle de réception de marchandise contient la chaîne d’information des aliments.
À ce titre, elle doit être archivée aussi longtemps que les étiquettes de traçabilité (6 mois pour les produits périssables, 5 ans pour les autres) pour assurer la traçabilité amont, interne et aval du produit en cas d’audit ou de contrôle sanitaire.
Fiches d'enregistrement des non conformités produits
Guide des bonnes pratiques
Guide des bonnes pratiques d'hygiène et hygiène alimentaire
Hygiène alimentaire : https://agriculture.gouv.fr/guides-de-bonnes-pratiques-dhygiene-gbph
Règles d'hygiène alimentaire dans la restauration et les commerces alimentaire: https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R58949
Rappel des températures: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/HA-commerce-vends-des-denrees-alimentaires.pdf
Échanges de pratiques en épicerie
Exemples de mesures HACCP mises en places dans les activités de GRAP > ICI <
RH et droit du travail
Controle réalisé par Inspection du travail
Les documents controlés par inspection du travail
Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié. L'employeur y consigne le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés.
Les cotisations à la médecine du travail couvre notamment une aide à la rédaction du DUERP => ne pas hésiter à les solliciter. Voir avec le pôle social pour en savoir plus.
Le DUERP plus en détail ICI
Guide rédiger son DUERP par GRAP https://nuage.grap.coop/s/KgmgnmBMabBeR6N
Modèle DUERP à télécharger: https://nuage.grap.coop/s/9gg3gAFJ8sWwwif
Registre du personnel
Un registre du personnel doit être ouvert dès l'embauche de votre 1er salarié.
Dans GRAP, que vous soyez intégrés ou associés, c'est le pôle compta qui gère le registre du personnel.
Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent être mentionnés dans une partie spécifique de ce registre.Aucune forme spécifique n'est imposée, mais certaines mentions sont obligatoires.Les informations suivantes doivent être inscrites dans l'ordre des embauches (ou des arrivées) :
-
Identification du salarié : nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité
-
Carrière : emplois, qualifications, date d'entrée et de sortie de l'entreprise
-
Type de contrat : CDI : CDI : Contrat de travail à durée indéterminée, contrat d'apprentissage, contrat d'insertion professionnelle, CDD : CDD : Contrat à durée déterminée, mise à disposition par un groupement d'employeurs ou par une entreprise de travail temporaire, travail à domicile
-
Pour les travailleurs étrangers : type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail
-
Pour les stagiaires et les volontaires en service civique : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage ou de la formation en milieu professionnel, nom et prénoms du tuteur, lieu de présence du stagiaire
-
Pour les salariés à temps partiel : mention « salarié à temps partiel »
-
Pour les salariés dont l'autorisation d'embauche ou de licenciement est requise : date de cette autorisation ou date de la demande d'autorisation
Le salarié en situation de télétravail régulier doit être identifié comme télétravailleur sur ce registre.
En cas de succession de contrats de travail, la date d'entrée et de sortie correspondantes sont indiquées pour chaque contrat sur une nouvelle ligne du registre.
Ce registre peut être tenu sur support numérique après consultation du comité social et économique (CSE).
Il est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des membres du CSE.L'absence de registre, l'absence de mise à jour ou l'oubli de mentions obligatoires peuvent entrainer jusqu'à 750 € d'amende par salarié concerné.
Affichage obligatoire RH
Voir fiche affichage obligatoire
Attestation d'aptitude du personne délivrée après la visite médicale
A compter du 1er novembre 2017, le professionnel de santé doit remettre à l’employeur ainsi qu’au salarié, à l’issue de des visites en santé travail (hormis pour la visite de pré-reprise), un document conforme à l’une des 4 annexes établies par l’arrêté.
Ainsi, une « attestation de suivi » (annexe 1) doit être remise à l’issue de la visite d’information et de prévention initiale ou périodique, de la visite de reprise, de la visite occasionnelle ainsi que, pour le salarié affecté à un poste à risque, de la visite intermédiaire.
Un « avis d’aptitude » (annexe 2) doit être remis à l’issue de l’examen médical d’aptitude d’embauche ou périodique, de la visite de reprise ou de la visite occasionnel du salarié affecté à un poste à risque. Cet avis d’aptitude ne concerne pas les salariés qui ne sont pas affectés à un poste à risque puisque leur aptitude n’a plus à être appréciée depuis le 1er janvier 2017.
Si l’inaptitude du salarié est constatée (par le médecin du travail), un « avis d’inaptitude » (annexe 3) doit être délivrée à l’issue de toute visite réalisée dans le cadre du suivi du salarié à l’exception de la visite de pré-reprise (visite d’information et de prévention initiale ou périodique, visite de reprise, visite occasionnelle, examen médical d’aptitude à l’embauche ou périodique, visite intermédiaire).
Pour finir, une des nouveautés plus marquées de cet arrêté réside dans la création de l’annexe 4 (intitulée « proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail »).
Cette annexe doit être utilisée dès lors que le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail - si le protocole établi le permet - souhaite proposer des mesures d’aménagements, mesures individuelles, notamment dans le cadre de l’édition de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude du salarié affecté à un poste à risques.
Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié, il reste tenu de faire part de ses conclusions écrites directement dans le corps de son avis d’inaptitude.
Convention collective
CHR: https://code.travail.gouv.fr/convention-collective/1979-hotels-cafes-restaurants
Epicerie: https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000005689453/?origin=list
Boulangerie- Patisserie : https://code.travail.gouv.fr/convention-collective/843-boulangerie-patisserie-entreprises-artisanales
Brasserie:
Vin:
Restauration collective: https://code.travail.gouv.fr/convention-collective/1266-restauration-de-collectivites
Les documents controlés par l'URSSAF
Déclaration unique de l'employeur
La Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE) est un acte juridique qui donne la possibilité à l'employeur d'offrir des avantages supplémentaires à ses salariés, sans nécessité de modifier leurs contrats de travail ou d'obtenir un accord collectif. Ces avantages peuvent couvrir divers domaines, tels que la mise en place d'une mutuelle, d'un régime de retraite complémentaire, ou encore l'octroi de primes exceptionnelles.
Les enjeux de la DUE sont multiples. Elle offre à l'employeur une certaine flexibilité dans la gestion de son entreprise, tout en favorisant le bien-être et la fidélisation des salariés. Toutefois, sa mise en place nécessite une rédaction précise et rigoureuse pour être valide, et elle doit être communiquée à tous les salariés concernés.
Pour mettre en place cet acte juridique en entreprise, la première étape consiste à rédiger un document détaillé précisant les avantages accordés aux salariés, ainsi que les modalités de mise en place et de financement de ces avantages.
Ensuite, chaque salarié doit être informé individuellement de cette décision. Cette information peut prendre la forme d'une remise en main propre contre liste d'émargement, d'un courrier recommandé ou d'une publication sur l'intranet de l'entreprise.
Il est recommandé d'obtenir les conseils d'un professionnel du droit du travail ou d'un responsable RH pour s'assurer de la conformité de la procédure avec le code de la sécurité sociale et les autres réglementations en vigueur.
Enfin, elle doit être conservée précieusement par l'employeur, car elle peut être demandée lors d'un contrôle de l'URSSAF ou en cas de litige avec un salarié.
Pour en savoir plus: https://www.eurecia.com/blog/decision-unilaterale-employeur/
Déclaration préalable à l'embauche
La DPAE doit obligatoirement être adressée, au plus tôt 8 jours avant l'embauche (et avant la mise au travail effective du salarié) à l'Urssaf, sauf utilisation de dispositifs simplifiant les formalités d'embauche des petites entreprises.
La DPAE permet d'effectuer en une seule démarche les formalités suivantes :
- demande d'immatriculation de l'employeur à la sécurité sociale en cas de 1re embauche d'un salarié,
- de création ou d'acquisition d'une entreprise employant des salariés,
- demande d'affiliation au régime d'assurance chômage,
- demande d'adhésion à un service médical du travail,
- demande pour la visite d'information et de prévention.
Contrat de travail
Voir fiche librairie du Pôle social
Emplois du temps et planning
La construction du planning de travail doit répondre à des exigences légales et réglementaires définies dans la loi et dans la convention collective dont relève l’entreprise.
En effet, pour tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe qui travaillent selon le même horaire collectif, l’employeur est tenu d’établir un planning de travail selon la durée légale du travail en France et dans le respect des obligations légales suivantes :
- le respect de la durée maximale de travail soit 10 heures de travail effectif par jour, 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne pour toutes périodes de 12 semaines consécutives.
- le respect d'un repos quotidien de 11h entre deux jours de travail.
- le respect d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
- le respect du temps de pause des salariés (pour les majeurs dès que votre temps de travail par jour atteint 6 heures de suite, vous devez bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.)
- les salariés ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
- chaque planning de travail réalisé doit indiquer la période concernée.
Possibilité d'avoir des dérogations
Une fois établi, le planning doit être respecté. Autrement dit, aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire de travail à l’exception des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sanctions en cas de non-respect de ces obligations légales
L’employeur qui ne respecte pas son obligation d’affichage s’expose à une contravention de 4ème classe, pouvant aller jusqu’à 750€.
Le refus de communiquer le planning de travail à l’inspecteur du travail est constitutif d’un délit d’obstacle puni d’un an d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende.
La loi n'impose pas de délai pour communiquer le planning de travail aux salariés.
Cependant, un accord ou une convention collective, de branche ou d’entreprise, peut imposer à l’employeur la communication du planning de travail aux salariés dans un délai précis. Par exemple, une convention d’entreprise peut prévoir que l’affichage des plannings de travail soit effectué en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Un accord ou une convention collective peut aussi définir un délai minimum de communication (article L. 3123-27 du Code de travail). Si une convention collective prévoit un délai, elle ne peut néanmoins pas aller au delà de 3 jours.
Malgré l’absence de dispositions légales, il est recommandé à l’employeur de communiquer le planning de travail aux salariés dans un délai raisonnable.
En l'absence de dispositions conventionnelles autres, ce délai de communication raisonnable est fixé à 7 jours.
Pour en savoir plus: https://www.kelio.com/fr/ressources/blog/1097-planning-travail-obligations-employeur.html
Fraude et concurrence
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique économique, en veillant au bon fonctionnement des marchés, au bénéfice des consommateurs et des entreprises.
La DGCCRF veille au respect et à la loyauté de la concurrence, à la protection économique des consommateurs ainsi qu’à la sécurité et la conformité des produits et des services de consommation.
Pour atteindre le niveau d’exigence attendu par les consommateurs, les produits sont soumis à des normes européennes et à des contrôles rigoureux. La DGCCRF, autorité compétente pour contrôler la conformité1 de ces produits, contribue par son action à lutter contre les fraudes et les pratiques déloyales.
- Concurrence: comment réguler les marchés?
- Consommation: comment protéger les consommateurs?
Fraudes alimentaires
- Faux aliments: remplacer un aliment par un autre, le diluer, l'adultérer...
- Fausses étiquettes: fraudes au made in France, AOP, IGP, bio, OGM non mentionnés...
Le terme « artisan » est une mention valorisante très appréciée des consommateurs. Certains producteurs nouveaux sur le marché peuvent être enclins à l’utiliser du fait de leurs méthodes de production ou des faibles volumes produits. Pour être qualifié d’artisan, le professionnel doit obligatoirement répondre aux critères imposés par la réglementation, comme être immatriculé au répertoire des métiers et répondre aux exigences de qualification ou d’expérience professionnelle.
- Risque sanitaire: périmés, contaminés, frelatés...
Règles d'étiquetage
- PRIX DU PAIN : règles d'affichage du prix du pain
- OEUFS : règles d'étiquetage des oeufs - mentions obligatoires
- ETIQUETAGE FROMAGE : lien vers une fiche complète sur l'étiquetage du fromage au rayon libre service
- FRUITS ET LEGUMES : Règles d'étiquetage des flegs
Lien vers l'outil du CTIFL qui permet de faire le point produit par produitORIGINE DES PRODUITS : étiquetage obligatoire pour les flegs, la viande, les fruits de mer, le miel et tous les ingrédients primaires
Pour assurer la lisibilité de l'étiquetage, le règlement européen INCO impose que les caractères soient d'une taille égale ou supérieure :
-
à 0,9 mm dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm²,
-
à 1,2 mm dans les autres cas.
Cette taille concerne le corps du texte.
Vente en vrac
- Huile olive
- Produits cosmétiques
- Mentions obligatoires vente à la découpe
- Controle métrologiques des balances
- Etiquetages des fruits et légumes
- Tares à la pesée
Contrats producteurs FEL
Certification bio
Controles pour assurer une concurrence équitable pour les agriculteurs et lieu de vente, tout en prévenant la fraude et en préservant la confiance des consommateurs”
Litiges commerciaux- Médiateur de la consommation
En cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit proposer au consommateur de parvenir à un accord sans intervention du juge. Cette procédure alternative de règlement des litiges est appelée médiation. Elle implique l'intervention d'un médiateur dont la mission est de proposer une solution permettant la résolution amiable du litige
Depuis le 1er janvier 2016, vous devez, en tant que professionnel permettre à tout consommateur l’accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution amiable de tout éventuel litige.
Seules sont concernées les activités qui pourraient avoir un litige avec un consommateur (la médiation de consommation ne concerne pas les litiges entre professionnels).
Ce point est désormais systématiquement contrôlé par la répression des fraudes, et passible d'une lourde amende (15 000€) en cas de non adhésion. Cette obligation concerne tous les commerces.
En ce sens, nous avons adhéré au nom de Grap au dispositif de SAS MEDIATION SOLUTION, pour les activités intégrées.
Aussi, nous vous proposons de faire de même pour votre structure. L'adhésion est de 3ans (durée égale pour tous les médiateurs), pour un coût annuel de 49€HT. Il n'y a pas d'obligation pour vous de choisir cet organisme, vous pouvez librement vous adresser à toute structure officiellement référencée par le gouvernement.
Une fois la convention signée avec un organisme, il faudra informer vos clients en leur transmettant les coordonnées de ce médiateur, dans les mentions légales de votre site internet, un affichage en boutique, ou encore la mention sur vos bons de commande à destination des clients, dans vos CGV si vous en avez.
A quelle condition un consommateur peut saisir un médiateur de la consommation?
Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle.
- La demande n'est pas manifestement infondée ou abusive.
- Le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal.
- Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.
- Le litige est compatible avec la médiation (les domaines liés à la santé, à l’intérêt général ou à l'enseignement supérieur sont incompatibles avec la médiation).
À savoir
Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.
Information à destination du consommateur
Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel.
À noter
le professionnel doit également fournir, sur son site internet, un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL).
Il doit inscrire ces informations, de manière visible et lisible, sur son site internet et ses documents commerciaux (CGV et bons de commande). En l'absence de tels supports, tout autre moyen approprié est autorisé (par voie d'affichage, par exemple).
Le professionnel doit informer le consommateur à 2 reprises :
- Avant la conclusion du contrat
- En cours de contrat, suite à une réclamation préalable du consommateur qui n'aurait pas abouti.
Attention
Le non-respect de ce dispositif est sanctionné d'une amende administrative de 3 000 € pour un entrepreneur individuel et 15 000 € pour une société.
Qui paie la médiation?
La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût.
Le médiateur communique au professionnel ses tarifs et ses conditions financières (à l'acte, au forfait ou par abonnement). Les tarifs peuvent évoluer en fonction du montant du préjudice en jeu.
À noter
si le consommateur fait le choix de recourir aux prestations d'un avocat ou d'un expert au cours de la procédure de médiation (ce qui n'est pas obligatoire), il réglera lui-même les honoraires qui lui incombent.
Que fait le médiateur en cas de désaccord des parties?
Si les parties ne parviennent pas à trouver un accord seules, le médiateur de la consommation propose, dans un délai de 90 jours, une solution permettant la résolution amiable du litige. À charge pour les parties de l'accepter ou de la refuser.
En cas de refus, les parties peuvent décider de poursuivre leur litige devant le juge judiciaire.
Pour en savoir plus
Lien vers le site internet du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/mediation-de-la-consommation
Ressources activités
Voici une proposition de texte type dans lequel figurent les mentions obligatoires : https://nuage.grap.coop/f/7699363
Fiscalité
Inspection des finances publiques
Incendie/ Sécurité/ Accessibilité
L'exploitant est responsable du respect des règles de sécurité dans son ERP. Il est soumis à différents contrôles.
Les différents documents et acte à réaliser et à présenter en cas de contrôle
Registre de sécurité
L'exploitant d'un ERP a l'obligation de tenir un registre de sécurité sur lequel figurent les renseignements indispensables au service de sécurité :
- Liste du personnel chargé du service d'incendie
- Consignes générales et particulières en cas d'incendie
- Consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap
- Dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu
- Dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Plan évacuation
Le plan d'évacuation des locaux, accompagné des consignes de sécurité, doit être affiché :
-
à chaque niveau desservi par une cage d'escalier ;
-
dans chaque salle pouvant contenir au moins 5 personnes ;
-
dans les vestiaires et les salles de repos du personnel.
Il doit indiquer :
-
les itinéraires d'évacuation vers l'extérieur ;
-
les barrages (ou robinet de coupure) du gaz, de l'eau et de l'électricité ;
-
l'emplacement des extincteurs et des trappes de désenfumage.
Consuel/ rapport de bureau de contrôle
Ces rapports peuvent être consignés dans un registre. Ce registre contient les résultats des vérifications éléctriques, les justfications des travaux et des modifications effectués pour corriger les défauts constatés.
Les rapports établis à la suite de ces vérifications effectuées par un organisme accrédité sont annexés à ce registre.
Ce registre est tenu à disposition de l'inspection du travail
Visite annuelle de contrôle des installations (élec, gaz, incendie,...)
Dans les ERP, les installations techniques (systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques, appareils de secours, éclairage, gaz, ascenseurs, etc) et les dispositifs de prévention des incendies doivent être vérifiés avant leur ouverture au public et chaque année au cours de leur exploitation :
- Soit par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur
- Soit par des techniciens compétents (entreprises locales, artisans, employés communaux).
Le contrôle périodique obligatoire en ERP de la 5ème catégorie concerne :
- Les installations électriques (tous les ans),
- L’éclairage de sécurité (tous les deux ans),
- Le paratonnerre (tous les ans),
- Les installations de gaz combustibles (tous les deux ans),
- Les installations de chauffage (tous les deux ans),
- Les appareils de cuisson et de remise en température (tous les deux ans),
- Les installations de désenfumage (tous les deux ans),
- Les ascenseurs (tous les cinq ans),
- Les extincteurs (tous les deux ans),
- Les installations de gaz médicaux (tous les ans),
- L’équipement d’alarme (tous les deux ans),
- Le système de détection automatique d’incendie (tous les ans).
- Nettoyages des conduits d'extraction d'air vicié (tous les ans)
Les rapports de vérification périodiques sont demandés par les autorités et la compagnie d’assurance en cas de sinistre (incendie, explosion, casse de matériel, etc.). Il est donc primordial d’effectuer les contrôles périodiques obligatoires.
Un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant. Les résultats de ces vérifications ainsi que leur date de réalisation doivent être consignés dans le registre de sécurité.
Affichage de la consigne de sécurité incendie
Une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
- 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
- 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
La consigne de sécurité incendie indique :
- 1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
- 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
- 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public
- 4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
- 5° Les moyens d'alerte ;
- 6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
- 7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents
- 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Plan d'évacuation (facultatif)
Les plans d’évacuation ont pour objectif, en cas d’incendie ou d’alerte, d’assister les personnes à se mettre en sécurité suivant un itinéraire d’évacuation planifié (dégagements, sorties, espaces d’attente sécurisés …). De plus, il permet d’indiquer l’emplacement des moyens d’alarme et les équipements de première intervention.
Pour être totalement efficace, accompagner les plans d’évacuation d’une signalétique, indiquant les voies d’évacuation et le positionnement des extincteurs.
Le plan d’évacuation est-il obligatoire ?
Non, la réglementation n’impose pas directement la mise en place de plan de évacuation.
Attention, le code du travail et la réglementation concernant les ERP (Etablissements Recevant du Public) impose la mise en place de consignes ou d’instruction de sécurité incendie. Pour répondre à cette obligation, il est totalement pertinent de mettre en place des plans d’évacuation.
Le deuxième point important à noter est que les commissions de sécurité, qui supervisent les Établissements Recevant du Public (ERP), peuvent exiger l’ajout de plans d’évacuation. Bien que la réglementation n’en fasse pas une obligation directe, les membres de la commission peuvent estimer nécessaire l’implémentation de ces plans en se basant sur leur évaluation des risques.
Une obligation pour les ERP avec locaux de sommeil
Seule exception, les ERP (Etablissements Recevant du Public) de type locaux de sommeil (hôtels et autres établissements d’hébergement). Ces derniers doivent avoir un plan sommaire dans chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie.
Quels sont les éléments clés à inclure dans un plan d’évacuation ?
Le plan d’évacuation doit indiquer les éléments suivants :
- les cheminements principaux du niveau concerné
- les cloisonnements
- les itinéraires d’évacuation
- les moyens de déclenchement d’alarme
- les portes de recoupement et les espaces d’attente sécurisés
- l’emplacement de l’observateur
- l’emplacement des moyens de premier secours
Comme expliqué précédemment, les plans d’évacuation peuvent faire fonction de consignes ou d’instruction en cas de départ d’incendie. Il est donc pertinent d’indiquer les informations suivantes :
- Le matériel d’extinction positionné à proximité
- L’identification des personnes chargées de manipuler les extincteurs
- L’identification des personnes chargées de diriger l’évacuation
- Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées
- L’identification des personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers
- L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours
- Le devoir, pour toute personne aperçevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours.
La norme NF X 08-070 version décembre 2023 détaille méthodiquement la procédure d’élaboration d’un plan d’évacuation. Elle spécifie les éléments essentiels à intégrer dans ce plan, tels que les voies d’évacuation et les points de rassemblement. Cette norme fournit aussi des directives précises concernant l’échelle appropriée à utiliser ainsi que les pictogrammes normalisés à afficher pour marquer clairement les différents composants du plan, garantissant ainsi leur identification rapide et efficace en cas d’urgence.
Quelle dimension pour le plan d’évacuation ?
Les plans d’évacuation sont conçus pour une compréhension rapide et claire. Les voies de sortie, comme les couloirs, escaliers et espaces ouverts, doivent être clairement distingués et mis en évidence par rapport aux autres espaces.
Concernant les dimensions, les plans doivent être conçus à une échelle minimale de 1:250, bien qu’une échelle plus grande comme 1:100 soit également acceptable. La taille minimum d’un plan d’évacuation, incluant ou non des instructions, devrait être de 297 x 420 mm (format A3), à l’exception des plans destinés à être affichés dans des pièces individuelles, où un format plus petit de 210 x 297 mm (format A4) peut être utilisé.
Où positionner un plan d’évacuation ?
En toute logique, les plans d’évacuation doivent être installés là où se trouvent les personnes susceptibles de devoir évacuer le bâtiment. Cela concerne, par exemple, les grandes salles pouvant accueillir de nombreuses personnes, les paliers des cages d’escalier, et les dégagements importants.
Les plans doivent être placés à hauteur des yeux (il est conseillé de les installer à une hauteur de 1,50 m), de manière à être rapidement identifiés et facilement visibles. Ils devraient être fixés au mur de façon solide, pour ne pas être endommagés au premier choc ou frottement.
Dans certains établissements de travail, il y a une obligation d’affichage des consignes de sécurité. Cela concerne les bâtiments :
- où sont réunies habituellement plus de 50 personnes,
- et / ou, quelle que soit leur taille, les entreprises où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables
Dans ce cas, la consigne de sécurité devait être affiché :
- Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes
- Dans les locaux où sont stockés ou manipulés des produits ou matières facilement inflammables ou explosives.
- Dans chaque local ou dégagement desservant un groupe de locaux.
Pour les autres cas, les plans d’évacuation doit être situé :
- aux points stratégiques de l’itinéraire d’évacuation (à chaque étage aux points d’accès principaux, dans chaque zone ou compartiment, à proximité des ascenseurs et des escaliers, aux principales jonctions et intersections,
- à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d’évacuation, comme par exemple l’entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons, cafétérias, bureaux, lieux de réunion, salles d’attente, cuisine, chambres d’hôtel, …
Les autres affichages obligatoires pour la sécurité incendie
Le plan d’évacuation, bien qu’essentiel, ne suffit pas pour agir efficacement en cas de départ de feu. Il est complémentaire à une signalétique claire, indiquant les voies d’évacuation ou issues de secours, souvent marquées par des flèches vertes. Dans certains cas, ces indicateurs sont lumineux et s’activent en cas de coupure de courant, formant ainsi un BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité).
De plus, certains établissements doivent être équipés d’un plan d’intervention, destiné aux services de secours pour organiser leur intervention. Ce plan est notamment obligatoire pour tous les établissements situés en étage ou en sous-sol.
Enfin, le matériel de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, etc.) doit être clairement identifié et accessible, avec un balisage situé à hauteur des yeux.
Formation et information des salarié.es
Obligation de l’employeur de former et informer les salarié·es sur les risques incendies
FORMATION
La participation à une formation incendie est obligatoire pour TOUTE l’équipe, sachant que le premier et principal responsable en matière de risque incendie est l’exploitant de l’établissement (comprendre « gérant·e ».
INFORMATION
- Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
Obligation de présence
Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Autre
Fiche de suivi des nettoyage de hotte
Fiche de suivi des changements d'huile de friture
La réglementation française (Décret n° 2008-184 du 26 février 2008), déclare comme impropres à la consommation humaine toutes les huiles dont la teneur en composés polaires est supérieure à 25 %.
Les composés polaires, qu’est-ce que c’est ?
Les composés polaires sont le résultat de la dégradation de la qualité des huiles de friture. Ils comprennent entre autres les acides gras libres (AGL), les mono et di-glycérides, les polymères de triglycérides, en des substances polaires oxydées comme les acides gras oxydés, etc.
En clair pour ne pas vous faire revivre vos cours de chimie du collège, retenons que :
- Plus l’huile est chauffée 🔥 plus elle se dégrade,
- La dégradation de l’huile la rend, au bout d’un certain temps 🕜, impropre à la consommation : elle est potentiellement cancérigène.
Comment mesure-t-on la dégradation de l’huile de friture ?
Il existe plusieurs manières de juger de la dégradation de l’huile de friture. Pour mesurer la teneur en composés polaires, utilisez :
- Des bandelettes de test,
- Des tests avec réactifs chimiques,
- Un testeur électronique.
Ces tests vous donneront une indication plus ou moins précise sur la teneur en composés polaires selon l’outil.
Peut-on se passer d’un testeur pour l’huile de friture ?
Oui : si vous changez votre huile très régulièrement, tous les 4 ou 5 utilisations, bien avant qu’elle ne brunisse ou ne devienne visqueuse, vous restez probablement en dessous de 25 % de composés polaires et vous agissez conformément à la réglementation.
La réglementation ne vous impose pas de réaliser un test de composés polaires. L’obligation est d’utiliser une huile saine dont le pourcentage de composés polaires est inférieur à 25 %.
Non : vous changerez probablement votre huile de friture trop souvent dans votre cuisine. L’huile coûte cher. La tester vous permet d’optimiser la fréquence de changement.
Ainsi, vous réaliserez des économies importantes à la fin de l’année. Cela impacte la marge de votre restaurant.
Comment conserver mon huile de friture plus longtemps ? ⏳
L’utilisation d’une huile de friture de bonne qualité et le respect des consignes suivantes vous permettrons d’utiliser votre huile de friture plus longtemps et donc d’en réduire le coût !
Pourquoi l’huile de friture se dégrade-t-elle ?
L’huile de friture se dégrade pour plusieurs raisons :
- Elle est trop chauffée
- Elle contient des résidus
- Elle contient de l’eau
- Elle est en contact avec l’air
Quels sont les bons gestes pour prolonger la durée de vie de mon huile de friture ?
- Évitez la surchauffe : Vérifiez les thermostats de vos friteuses. Ne chauffez jamais votre huile à plus de 180°C. Si elle est trop chauffée, elle s’abimera plus vite.
- Choisissez une huile de bonne qualité : la qualité de l’huile vous permettra de l’utiliser plus longtemps. Toutes les huiles n’ont pas la même résistance à la chaleur et leur durée de vie est impactée.
- Filtrez votre huile après chaque service pour éliminer les résidus qui carbonisent au cours des différentes chauffes.
- Après la filtration, stockez votre huile dans un bac fermé, à l’abri de l’air, idéalement en enceinte froide.
- Utilisez un bain d’huile spécifique par type d’ingrédients plongés dedans. Certaines préparations génèrent plus de résidus que les frites. Ceci permet aussi d’éviter les contaminations croisées pour les allergènes.
- Épongez vos ingrédients avant de les plonger dans les bains de friture, surtout pour les produits surgelés : l’eau qu’ils contiennent dégrade fortement l’huile de friture.
Pour l’huile de friture, quels relevés HACCP dois-je réaliser ?
Comme d’habitude, la méthode HACCP vous impose de réaliser un suivi par écrit. Concrètement pour devez faire 2 types de relevés HACCP concernant les huiles de friture :
- Noter le résultat de vos tests d’huile de friture et les dates de changement d’huile de friture,
- Intégrer le nettoyage de votre friteuse à votre plan de nettoyage et de désinfection et noter sa bonne exécution.
Les différents contrôles
Contrôle réalisé par la commission de sécurité
La CCDSA effectue des visites de contrôle à la construction, à l'ouverture et au cours de l'exploitation de l'ERP. Elle relève tous les manquements à la réglementation.
Les exploitants sont obligés d'assister à la visite de leur ERP ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
La commission contrôle les ERP en cours d'exploitation tous les 2, 3 ou 5 ans. La fréquence de ces visites varie en fonction du type d'activité et de la catégorie de l'établissement. Elle peut être modifiée à la demande du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.
Ces contrôles ont pour but de :
- Vérifier la conformité aux règles de sécurité et notamment le bon fonctionnement de tous les appareils de secours contre l'incendie et des appareils d'éclairage de sécurité
- Vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap
- S'assurer que les vérifications des installations et des équipements par des organismes et des personnes agrées ont été faites
- Suggérer les améliorations ou modifications à apporter dans le cadre de la réglementation
- Étudier d’éventuelles mesures d'adaptation
Après la visite, la commission de sécurité émet un avis favorable ou défavorable.
En cas de danger, il peut prendre un arrêté de fermeture de l'ERP dans lequel figurent la nature des aménagements et les travaux à réaliser et les délais d'exécution.
Contrôle réalisé par des organismes agréés
Les constructeurs, installateurs et exploitants font vérifier les installations et équipements de l'ERP (électricité, éclairage, équipement d'alarme, désenfumage, ascenseurs, extincteurs...).
Ces vérifications interviennent pendant la construction et régulièrement en cours d'exploitation.
Elles sont effectuées par des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur ou par des techniciens compétents.
Les procès-verbaux et compte-rendus des vérifications sont tenus à la disposition des membres de la commission de sécurité.
Ils sont communiqués au maire qui peut imposer des essais et des vérifications supplémentaires, après avis de la commission de sécurité compétente.
Contrôle réalisé par la police et la gendarmerie
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des ERP et relever les infractions aux règles de sécurité.
Activités reglementées
Débit de boissons
Commerce sédentaire
Certification Bio
Notification? Certification? Ou rien?
On distingue :
- la notification auprès de l’Agence bio : elle consiste à déclarer chaque année auprès des services de l’Etat son activité bio. Elle se fait exclusivement par internet : notification.agencebio.org
- la certification par un organisme certificateur indépendant
Je commercialise des produits bio dans mon épicerie, dois-je me faire certifier ? [1]
Cas n°1 : je ne vends que des produits préemballés
=> Dans ce cas il n’est pas nécessaire de vous faire certifier, la certification ne concerne que les produits vendus au poids. Vous êtes également dispensé de notification.
=> Dans ce cas, l’utilisation du mot bio est possible dans votre enseigne à condition quelle ne soit pas abusive (ex : 3 produits bios sur l’ensemble de la gamme), au risque d’une amende de la DGCCRF.
Cas n°2 : je vends des produits bio au poids mais je ne souhaite pas le mettre en avant dans ma communication et je ne fais pas mention de l’agriculture biologique en rapport avec les produits dans le magasin
=> Dans ce cas (bien rare) vous n’êtes pas obligés de vous faire certifier, mais (à priori), il convient de se notifier.
Cas n°3 : je vends des produits bio au poids et je souhaite communiquer dessus
Il est extrêmement probable que votre épicerie commercialise des produits alimentaires biologiques en vrac, pour un montant d’achat supérieur à 10 000 € par an.
C’est le seuil au-delà duquel vous êtes obligés de certifier votre activité. En deçà de ce seuil, une notification seule est suffisante.
Même dans les cas de dispenses cités ci-dessus, l’utilisation de la marque AB sur les supports de communication (affiche, etc..) implique une autorisation à demander au préalable auprès de l'Agence Bio.
Même dans les cas de dispenses cités ci-dessus, l’utilisation de la marque AB sur les supports de communication (affiche, etc..) implique une autorisation à demander au préalable auprès de l'Agence Bio.
Vente en ligne ou à des professionnels
Si vous revendez des produits biologiques à des clients professionnels, alors vous êtes considérés comme grossistes. Vous avez l’obligation de faire contrôler les produits biologiques que vous commercialisez pour apporter la garantie biologique à vos clients.
Dans le cas de la vente en ligne ou par correspondance de produits biologiques, vous êtes également soumis à une obligation de certification.
Je commercialise des produits bio dans mon épicerie, dois-je me faire certifier ? [2]
La certification est obligatoire si :
-
- Vente de vrac de plus de 10 000 euros de chiffre d'affaire (pour assurer la traçabilité des produits). Ce montant est rapidement atteint car cela comprend
-
-
-
-
-
- L'épicerie en vrac
- Le pain
- Les fruits et légumes
- Le fromage à la découpe
-
-
-
-
-
- Vente de vrac de plus de 10 000 euros de chiffre d'affaire (pour assurer la traçabilité des produits). Ce montant est rapidement atteint car cela comprend
=> TOUT CE QUI SE VEND AU POIDS
-
- Je fais une communication sur le fait de vendre ou distribuer des produits d'origine biologique.
Coût : 500 euros par an environ pour une épicerie
Au vu de leur CA toutes les épiceries de GRAP qui le souhaite ont besoin d'une certification
Je suis grossiste ou je vends des produits en ligne
Vous êtes distributeur grossiste ou détaillant. Vous avez l’obligation de faire contrôler les produits biologiques que vous commercialisez qu’ils soient emballés ou vendus en vrac, pour les grossistes ou la vente en ligne.
Dans ces deux cas, le contrôle consistera :
- en une réconciliation matière pour s'assurer que vous vendez bien ce que vous avez acheté en terme de quantités pour les produits certifiés AB,
- en un contrôle des certificats dont vous disposez : vous devez avoir préalablement récupéré les certificats de vos fournisseurs, même de produits emballés, pour pouvoir prouver que vous avez contrôlé leur certification, et qu'elle est à jour.
Si vous vendez à des professionnels, il faudra indiquer sur vos factures que ces produits sont bios. Mais si le code certificateur est bien présent sur l'emballage du produit, alors il n'est pas nécessaire que votre fournisseur l'ait indiqué sur sa facture.
La certification ne vous impose pas une distribution exclusive de produits bios, mais dans ce cas, il faut bien vous assurer que la communication que vous faites de votre activité ne peut pas porter à confusion, et que l'utilisation générique de la mention "bio" par exemple, n'est pas abusive (si vous distribuez aussi des produits non certifiés par exemple).
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher d'Alpes Contrôle.
Infos en ligne : https://certification-bio.fr/distributeur/
C'est ma première année d'activité, dois je me faire certifier avant l'ouverture?
Il n’est pas nécessaire de faire toute la démarché de certification en AB avant l’ouverture.
Cependant si vous voulez mentionner le bio dans votre communication pré-ouverture dans la presse, supports visuels et enseigne) il vous faudra la certification.
Actuellement, dans la mesure où tous vos produits vendus sont certifiés AB (veillez à conserver les certificats AB pour un contrôle éventuel de la DGCCRF) et que vous serez notifié à l’Agence Bio, vous pouvez indiquer «magasin bio » sur votre vitrine.
Toutefois, lorsque vous dépasserez le seuil d’achat de 10 000 € HT/an de produits bio en vrac, et/ou à changer de lieu pour le stock de vos marchandises bio, ou à ouvrir un site e-commerce, vous devrez vous faire certifier.
Source : mail de réponse de l'Agence Bio à la P'tite distrib
Certification des produits non-alimentaires
Aujourd’hui, la certification biologique selon le règlement européen ne s’applique qu’aux produits animaux et végétaux bruts ainsi qu’aux produits transformés destinés à l'alimentation humaine et animale*.
En l’absence de règlementation biologique européenne ou nationale pour les autres produits transformés, des cahiers des charges privés ont vu le jour dans le but d’encourager et de valoriser les pratiques respectueuses de l’environnement. C’est le cas de GOTS permettant d’harmoniser au niveau mondial les pratiques en matière de produits textiles ou encore du label COSMOS pour les cosmétiques biologiques ou naturels Ecocert sélectionne avec rigueur les labels présentant des critères avec de fortes exigences en matière environnementale et sociétale et lorsque ceux-ci n’existent pas, les créé afin de pallier le manque de reconnaissance pour certaines filières. Il existe ainsi le référentiel ecodétergents pour les produits de nettoyage ou encore un référentiel concernant les textiles écologiques et recyclés (ERTS) ...
Ecocert pour en savoir plus: https://www.ecocert.com/fr-FR/guides-certification/agriculture-biologique-europe-ue-n-848-2018
Processus de certification et controle
Si vous souhaitez communiquer sur le bio, vous devez être notifiés auprès de l’Agence bio et contrôlés par un organisme certificateur.
Nous avons des tarifs négociés avec Alpes Contrôle : https://nuage.grap.coop/s/8qrGfk4Jd4oK6wb
Sont considérés produits en vrac tous les produits vendus au poids : fruits et légumes, fromages à la coupe, pain, pâtes, riz, vinaigre, etc. Les produits d’hygiène et les produits cosmétiques ne rentrent pas dans le champs de la certification AB.
Quand se faire certifier?
Il n’est pas nécessaire de faire toute la démarché de certification en AB avant l’ouverture. Cependant si vous voulez mentionner le bio dans votre communication pré-ouverture dans la presse, supports visuels et enseigne) il vous faudra la certification.
Actuellement, dans la mesure où tous vos produits vendus sont certifiés AB (veillez à conserver les certificats AB pour un contrôle éventuel de la DGCCRF) et que vous serez notifié à l’Agence Bio, vous pouvez indiquer «magasin bio » sur votre vitrine.
Toutefois, lorsque vous dépasserez le seuil d’achat de 10 000 € HT/an de produits bio en vrac, et/ou à changer de lieu pour le stock de vos marchandises bio, ou à ouvrir un site e-commerce, vous devrez vous faire certifier.
Le processus de certification
-
Demande de devis auprès de Alpes Contrôle : https://certification-bio.fr/demande-de-devis/#distributeur
- Nous avons des tarifs négociés avec Alpes Contrôle.
-
Acceptation du devis et notification auprès de l’Agence Bio
-
Un Évaluateur Alpes contrôle passe pour faire un contrôle initial
-
Vous répondez ensuite au rapport de contrôle précisant les éventuelles non-conformités
-
Enfin, vous recevez un certificat de conformité en Agriculture biologique renouvelable tous les ans. Il vous permet d’apposer l’« eurofeuille », le logo européen de l’agriculture biologique et /ou la marque française AB sur les produits certifiés.
Le processus dure en moyenne un mois.
Chaque année, un audit de renouvellement de la certification est programmé, et un contrôle de surveillance a lieu de manière inopinée.
Les contrôles
Les contrôles portent sur les conditions de stockage et le transport de vos produits, ainsi que sur la traçabilité et les garanties biologiques.
Le certificateur a un rôle d’information sur les règles d’étiquetage de vos rayons vrac et sur la communication.
Passage 1 fois par an
https://www.ecocert.com/fr-FR/guides-certification/agriculture-biologique-europe-ue-n-848-2018
Exemples de points de controle:
Activité du magasin:
- Notification auprès de l'agence Bio
- Gestion de la mixité (doublon bio non bio) sur le vrac
- Activité de la transformation ou non de l'opérateur détaillant
- Balance entrée/ sortie afin de vérifier l’équilibre de la comptabilité matières.
Origine biologique des produits:
- Validité des licences et des certificats des fournisseurs de vrac.
- Garanties sur les certificats, les facture et bons de livraison.
- Garanties sur les étiquettes d'origines, les sacs, en stock, en rayon avec rapprochement de ces garanties avec les certificats, les les factures et/ ou bon de livraison et les étiquettes.
- traçabilité produits lorsque mixité sur le vrac
Information du consommateur:
- Mise en avant du caractère biologique des produits conformes (étiquettes, pancartes, certificats...)
- Etiquettes d'origines ou étiquettes modèles reprenant les informations de l'étiquette d'origine présentes en rayon (à la vue du consommateur)
- Etiquettes réalisées par le détaillant et collée sur les produits transformés conformes et validées.
- Absence de confusion entre les produits biologique, en conversion ou conventionnels. 5Règles de séparation)
- Références aux produits biologiques ou en conversio, et à l'organisme de certification correctes sur les pancartes, les affichettes, et les catalogues.
-
Les factures et bons de livraisons des produits mentionnant bien le caractère biologique des produits.
Si vous revendez des produits à des professionnels, alors vous devez préciser cette garantie sur les bons de livraisons et les factures que vous leur fournissez. La facture doit également indiquer le numéro de l’organisme de certification qui vous contrôle.
Autres points d'audits:
- Mesures de non contamination par des produits de nettoyage, des traitements phytosanitaires sur le lieu de stockage, le lieu de vente et le lieu de préparations.
- Libre accès pour prélèvement par la réalisation d'analyse.
Comment se déroule une visite de contrôle ?
La visite de contrôle peut durer 2h, une demi-journée voir une journée entière selon l’activité et la gamme de produits à certifier.
Elle comprend :
– une vérification documentaire (factures d’achat et de vente, certificats fournisseurs, cahiers de culture, registre d’élevage,registre de fabrication, test entrée/sortie …).
– une visite de l’entreprise qui permet de faire le tour des rayons, du stock...
Contact Alpes Contrôles
Contact
Alpes Contrôles Certification
3 bis impasse des prairies
P.A.E les Glaisins
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy
certification@alpes-controles.fr
04.50.64.99.56
Mixité des produits bios et nons bios
La mixité ne doit pas porter à confusion entre les produits biologiques, en conversion ou conventionnels, que ce soit pour les salariés du magasin ou pour les clients.
La cohabitation doit permettre d’éviter tout risque de contamination croisée accidentelle par les clients.
Dans le cas de la commercialisation de produits similaires (ex : Pommes bio et pommes non bio), une séparation physique est obligatoire, et une distanciation dans l’espace est recommandée.
Pour des produits différents (carottes et choux-fleur), une séparation physique suffit.
Cette séparation doit s’accompagner d’une communication claire en magasin, avec par exemple des codes de couleurs facilement compréhensibles par le consommateur. Il n’est pas obligatoire néanmoins d’indiquer sur l’affichage des produits non certifiés qu’ils ne le sont pas.
Règles en cas de mixité Bio et non bios
Doit on emballer les produits bios en cas de cohabitation de produits similaires ?- Juste les séparer sur le légumier, ne pas avoir de produits emballés bien identifiés et séparés dans les rayons
Si on annonce que l'on est un magasin de produits bio et locaux, il faut une majorité de produits bios => si ce n'est pas le cas on risque de se faire taper sur les doigts par les fraudes.
Quand on a un magasin qui s’appelle épicerie bio il n'y as de tolérance normalement sur les produits non bios.
Alpes Contrôle a une tolérance sur les produits Nature et Progrès, le Beaufort, la levure de bière, etc. (produits qui n'existent pas en bio).
L'organisme certificateur est en mesure de nous alerter lors des contrôles.
Certification partielle du magasin
Il est envisageable de demander une certification partielle, par exemple pour le rayon des fruits et légumes. Dans ce cas, la communication bio ne doit concerner que le rayon certifié.
Stockage
Le stockage des produits bio doit être réalisé dans un endroit clairement identifié, et tenu à l’écart des autres produits. Cela n’entraîne pas systématiquement un autre local.
La logique est la même qu’en magasin pour éviter la contamination croisée lors du réassort.
Guide d’étiquetage et affichage BIO en épicerie
Règles de base
Le respect des règles générales d’étiquetage s’impose !
-
Logo AB toujours facultatif, jamais obligatoire.
-
Logo Européen :
-
Produit pré-emballé : aucun logo n'est obligatoire sur l'étiquette en rayon car il apparaît déjà sur l'emballage du produit.
-
Produit en vrac : logo facultatif mais..
-
-
Mais mention "Bio" obligatoire
-
Numéro de l’OC obligatoire sur l’étiquette liée au produit (les écriteaux et pique prix ne sont pas concernés). Pour la vente en vrac avec trémies, les mentions indiquées sur la trémie sont considérées comme une étiquette. En conséquence, le code de l’OC du dernier préparateur (celui qui remplit et étiquette la trémie) doit figurer sur cette étiquette. Exemple : FR-BIO-15 pour Alpes Contrôles.
-
Pour que le texte s'affiche sur vos étiquettes, un mini paramétrage est nécessaire sur Odoo : demandez au pôle info de le faire quand votre activité est certifiée bio !
-
Mention d’origine : si le logo européen est utilisé alors les mentions d’origine sont obligatoires. Il s’agit de l’origine des matières premières agricoles qui composent le produit et non du lieu de fabrication !
-
Si le logo Européen est utilisé en couleur il doit être utilisé avec la bonne couleur.
-
-
-
- Attention, pour les produits en conversion, la mention "en conversion vers l’AB" doit être affichée.
Schéma co-construit avec Alpes Contrôles qui représente tous les cas d'usage selon que le produit soit manufacturé ou vrac
Facture et bons de livraisons
Vos factures et bons de livraisons devront indiquer le caractère biologique du produit.
Où rentrer les infos dans Odoo ?
Toutes ces informations sont conditionnées au bon remplissage de l'onglet "Informations complémentaires" de la fiche article sur Odoo.
La certification Alpes Contrôle apparaît uniquement sur les produits alimentaires, il faut donc que la case "Est alimentaire" présent sur la fiche article soit cochée ! Normalement, si vous avez sélectionne une catégorie d'article adéquate, c'est coché automatiquement.
Précisions sur l'histoire de l'AB français vs La Feuille Européenne
Pour les distributeurs détaillants, obligation d’apposer un code organisme certificateur sur les étiquettes de vente de produits vrac faisant référence à l’agriculture biologique.
Le label AB (Agriculture Biologique) est la possession du ministère de l’agriculture. Il est ainsi l’unique certification officielle en France.
Le cahier des charges du logo a bénéficié d’un alignement sur le label bio de l’Union Européenne en 2009. Le label AB est le seul obligatoire pour les produits bio en Europe. En conséquence, les marques peuvent se contenter d’afficher le logo Euro-feuille.
Différemment du label français AB, le logo européen Eurofeuille est obligatoire pour les produits biologiques. Il s’agit d’un label communautaire qui doit être accompagné d’une annotation qui indique la provenance des matières premières et le numéro de l’organisme certificateur.
Traçabilité
Vous devez pouvoir présenter les documents suivants lors du contrôle :
- une liste de vos fournisseurs de produits vendus au poids
- les documents de certifications de vos fournisseurs
- Les factures et bons de livraisons des produits mentionnant bien le caractère biologique des produits.
Si vous revendez des produits à des professionnels, alors vous devez préciser cette garantie sur les bons de livraisons et les factures que vous leur fournissez. La facture doit également indiquer le numéro de l’organisme de certification qui vous contrôle.
Lors du contrôle, un exercice de traçabilité est réalisée ainsi qu’une balance entrée/ sortie afin de vérifier l’équilibre de la comptabilité matières.
Bio et nuisibles
On peut utiliser des produits chimiques, seule contrainte:
- Bien ranger les produits dans des espaces dédiés.
- Prendre des précautions d'usages pour le ramassage des cadavres
- Précautions à prendre sur la disposition des appats et la protection des enfants. Usage des boites appâts recommandés
Restauration et mention de Bio
Le professionnel qui souhaite mettre des produits bio à sa carte a plusieurs options :
1) indiquer qu’il utilise des produits bio entrant dans la composition de ses plats, par exemple l’utilisation de tomates et viande bio entrant dans une sauce bolognaise, ce qui ne lui permettra pas de dire que les pâtes à la bolognaise qu’il a mises à sa carte sont bio. => Il n'y a dans ce cas là pas besoin de certification.
2) Pour qu’un plat soit étiqueté bio, il faut que le restaurateur ait une certification Plats et menus bio. Chaque plat ainsi certifié devra avoir au moins 95 % d’ingrédients bio en poids. Un menu certifié bio ne devra inclure que des plats et denrées bio, boissons comprises.
=> La mention ou le logo bio ne pourra être apposé que pour les plats et menus certifiés.
Être certifié pour pouvoir communiquer sur les plats/ menus/ restaurant.
Depuis janvier 2020, il existe une alternative pour les professionnels misant sur une cuisine où la part de bio est importante.
Il s’agit de la certification Quantité produits bio. Cette certification implique l’utilisation de 50 %, 75 % ou 95 % minimum de produits bio (en valeur d’achat). Ainsi, si l’on vise une labellisation 75 %, la part de denrées alimentaires et de boissons bio (eaux exclues) doit représenter entre 75 % et 95 % de la valeur totale des achats de denrées alimentaires effectuées par l’établissement.
Il est bien sûr possible de cumuler les labels Quantité produits et Plats et menus (elle est même automatique dans le cas d’une certification 95 % bio).
Plus d'infos sur le site de l'Agence Bio.
Echanges de pratiques entre épiceries
Chaque mois une visio d'échange de pratique en épicerie est proposée à toutes personnes souhaitant discuter et échanger sur des thématiques diverses qui touche les activités.
Vous trouverez ci dessous, quelques résumés des échanges passées qui concerne cette fiche librairie
https://nuage.grap.coop/f/8516817
FOCUS ACTI_Epicerie
Traçabilité
Législation particulière applicable à la traçabilité, du fait que les denrées alimentaires nécessitent une traçabilité importante. Il y a donc plusieurs obligations à connaître sur les produits qui vont être vendus en épicerie.
Étiquetage obligatoire (Général, Vrac...) + affichage des prix
Définition : capacité de suivre les déplacements d'un aliment parmi les stades précis de la production, de la transformation, de la distribution.
Particularité : la loi n'impose aucune obligation de moyen, mais une obligation de résultats !
Traçabilité amont
- Identifier les fournisseurs: nom, adresse, nature des produits reçus
- Date de réception, numéros de lots, quantités, descrption du produit, fiches techniques des intra enregistrement- controle à recption, bons de livraison et facture.
Traçabilité interne
- Il est impératif de pouvoir montrer l'étiquette correspondante aux produits en cours d'utilisation (alimentaire et non alimentaire).
- Pour le vrac, étiquette à conserver jusqu'à la fin de la DDM.
- On peut noter dessus la date d'ouverture et la date de fin de commercialisation.
=> L'objectif est de savoir sur quelle période le produit (et son numéro de lot) a été mis en vente afin de pouvoir faire des rappels.
Possible également d'effectuer la traçabilité en prenant des photos.
Pour l'information client, il peut être utile d'indiquer en plus de la DDM, la date d'ouverture du sachet (ou date de transvasement en silo), et la durée d'utilisation recommandée après cette ouverture.
Etiquetage des Fruits et Légumes : synthèse ou version longueEiquetage du vrac : il est possible de noter sur l'étiquette du silo : "N° de lot : sur demande, DDM : sur demande"
Traçabilité aval
- B to B: Identifier les clients: nom, adresse et nature des produits livrés.
- Date de livraison, numro de lots, quantités et description produit
Les documents de la traçabilité
- Factures
- Bon de livraisons
- Etiquette produits
- Dates d'utilisation
- Fiche de production si nécessaire
On peut utiliser le support que l'on souhaite pour conserver ces éléments (numérique, cahier, classeur) mais obligation de les garder.
En savoir plus
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/fiche_cma_tracabilite.pdf
Des formations sont disponibles afin d’acquérir les compétences nécessaires propres à la question de la traçabilité des denrées (ex : https://www.epiciersdefrance.org/formations-epiciers/tracabilite-alimentaire-regles-etiquetage )
Obligations relatives à la vente en vrac
La vente en vrac est définie comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réutilisables (cette définition a été introduite en 2020 dans le code de la consommation, par la loi sur la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, dite « AGEC »).
Ces contenants peuvent être fournis par le professionnel ou le consommateur, avec certaines restrictions.
La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.
Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions pour des raisons de santé publique.
La vente en vrac est possible en magasin et en vente sur internet ou à distance.
Précautions à prendre lors de la vente en vrac
Alimentarité des contenants
Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, les professionnels doivent s’assurer que les contenants, qu’il s’agisse des contenants de stockage ou de recueil des denrées alimentaires, sont adaptés à l’usage préconisé. Ainsi, les contenants destinés aux denrées alimentaires doivent être aptes au contact alimentaire (c’est-à-dire ne portant pas atteinte à la santé des personnes, notamment du fait de la migration de substances chimiques).
Il incombe donc aux professionnels :
- de veiller à ne mettre au contact de denrées alimentaires que des matériaux destinés à cet usage en s’assurant que les matériaux utilisés disposent d’une déclaration de conformité aux textes réglementaires applicables lorsque la réglementation le prévoit ou à défaut en s’assurant auprès de leur fournisseur de la destination des matériaux et objets ;
- d’utiliser ces matériaux dans les conditions de mise en contact prévues (durée, température, usage répété ou usage unique...) dans la déclaration de conformité ou, en son absence, selon les instructions d’usage de l’étiquetage ou selon des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi.
En l’absence d’éléments attestant de l’aptitude au contact alimentaire, les contenants seront considérés comme inaptes au contact alimentaire.
Selon les types de produits, d’autres restrictions peuvent provenir des règlementations sectorielles ou des exigences de sécurité fixées par les fabricants.
- La gestion des contaminations croisées au regard du risque lié à la présence d’allergènes dans certaines denrées alimentaires est une problématique à part entière.
- S’agissant des produits cosmétiques, le risque principal est celui de la contamination potentielle lors du transfert du produit du contenant primaire du fabricant vers un autre contenant[1].
Pour ce qui concerne les produits chimiques, l’information du consommateur quant aux dangers potentiels doit être assurée quel que soit le mode de vente et le règlement n°1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit « CLP »[2] précise les conditions à remplir pour les emballages de substances ou de mélanges (solidité, résistance, absence de déperdition de contenu, absence d’interaction entre le contenant et le contenu…), c’est pourquoi la vente en vrac obéit à des règles particulières :
- Le distributeur fournit un conditionnement adapté et étiqueté en fonction du produit mis en vente aux consommateurs qui effectuent leur premier achat,
- Le distributeur est en mesure de vérifier que le produit vendu aux consommateurs qui apportent leur propre conditionnement vide déjà étiqueté, correspond bien au produit acheté et qu'il n'y a donc pas de modification depuis le dernier achat. En cas de changement de fournisseur ou de composition du produit, une information du consommateur devra être mise en place dans le magasin et le changement ou le réétiquetage des flacons devra être réalisé,
- Lorsque plus d'un produit est disponible à la vente en vrac, le distributeur s’assure que le consommateur remplit son flacon avec le produit correspondant à l'étiquetage, et non avec un autre, dont l'étiquetage serait différent,
- Le distributeur peut garantir que le consommateur ne réalise pas son propre mélange de plusieurs produits lors du remplissage du flacon.
Informations obligatoire et interdites
Le consommateur doit par ailleurs être correctement informé de la dénomination du produit et de la présence d’allergènes, informations obligatoires pour les denrées non préemballées.
Les allégations nutritionnelles ou de santé ne sont pas autorisées. Par exemple, il est interdit d’afficher « produit riche en oméga 3 » pour des graines de chia ou alors « une alimentation bio diminue les risques de cancer de 25 % ».
Affichage :
- Dénomination
- Origine des denrées
Obligations quand le client ramène son contenant
Si le consommateur est responsable de son contenant, il reste de la responsabilité du professionnel de s’assurer qu’il ne sert pas le consommateur dans un contenant « manifestement sale ou inadapté ».
En effet, l’article L.120-2 du code de la consommation dispose :
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté »
Il est préconisé de refuser les contenants (sacs en papier, boites d'oeufs) déposés par certains clients pour d'autres clients futurs car ceux ci peuvent comporter des risques physiques (bout de verre ou autre débris dans les sacs), biologiques (moisissures dans les sacs ou risque de listeria dans les boites d'oeufs).
Particularités produits
Les oeufs
La DCR (Date de Consommation Recommandée) correspond à la date d'expiration des oeufs.
- Extra frais => jusqu'au 9ème jour après la date de ponte (date de ponte obligatoire sur l'emballage).
- Oeufs frais => DDM de 28 jours à partir de la ponte.
Depuis 2022, ll est désormais possible de commercialiser les oeufs jusqu'à la DCR (28 jours après la ponte) au lieu de 21 jours. (texte de loi)
Désormais, les œufs peuvent donc être vendus et/ou donnés à des associations jusqu’à la date inscrite sur l’emballage, au même titre que tout autre produit !
Interdiction de proposer des boites d'oeufs à réutiliser (risque de transmission de la Listeria)
Conservation:
- Ne pas laver les oeufs (suppression de la pellicule protectrice)
- Stocker les oeufs dans un endroit frais avec peu de variations de tempéture ou frigo
- La variation de température entraine une porosité de la coquille et donc de potentiels contamination croisées (ne pas placer dans la porte du réfrigératuer)
- Pointe vers le bas pour éviter les échanges gazeux
Hulie d'olive
Lire la fiche ressources sur la réglementation : https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_huile_d_olive.pdf
La première étape est de faire une demande d'agrément de conditionneur d'Huile d'Olive auprès de France Agrimer pour obtenir votre numéro de conditionneur.
Les produits concernés :
- l’huile d’olive vierge extra,
- l’huile d’olive vierge,
- l’huile d’olive (composée d’huiles d’olive raffinée et d’huiles d’olive vierges),
- l’huile de grignon d’olive.
Ne sont pas visés :
- le conditionnement d’huile d’olive en mélange avec d’autres huiles,
- le conditionnement de denrées alimentaires contenant de l’huile d’olive.
Les obligations qui découlent de cette demande d'agrément :
- Tenue d’une comptabilité matière : Afin de justifier les mentions relatives à l’origine, la tenue d’une comptabilité matière est fortement recommandée (tableaux,...)
- Transmission d’informations à FranceAgriMer : Les opérateurs de conditionnement agréés devront transmettre semestriellement (au 15 du mois suivant le semestre) à FranceAgriMer - Délégation nationale de Volx. Ces états et déclarations peuvent être présentés sous une forme différente de celle des annexes correspondantes mais reprendront les informations énumérées dans ces dernières.
- un état des stocks reprenant les informations énumérées ci-dessous et reprises en annexe 8,
- une déclaration récapitulative (selon le statut, voir ci-après l’annexe correspondante) reprenant les entrées, sorties et prix de vente HT des huiles d’olive par catégorie d’huile avant conditionnement.
Vous devrez apposer une étiquette sur le bouchon (un peu comme un scellé) avec votre numéro de conditionneur + une étiquette sur la bouteille avec toutes les mentions obligatoires.
Vente de cosmétiques en vrac
Les distributeurs qui vendent en vrac des produits cosmétiques liquides ou en poudre (les solides sont exclus) sont considérés comme des conditionneurs de produits cosmétiques, étant donné qu'une étape de remplissage dans un contenant réutilisable ou réemployable a lieu dans le point de vente.
A ce titre, les commerces qui distribuent ces produits en vrac sont soumis à une déclaration préalable de conditionnement qui peut se faire en ligne sur le site de l'ASNM : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/declarer-des-etablissements-de-fabrication-ou-de-conditionnement-de-produits-cosmetiques
Il convient de sélectionner "conditionnement primaire" dans le champs "nature des activités" et ne pas joindre de plan des locaux. Il est possible de faire une seule déclaration pour plusieurs établissements en joignant la liste des établissements dans le champs prévu pour le plan des locaux.
Reconditionnement des produits et date limite
Dès lors que des produits sont déconditionnées et mis dans des silos ou dans d'autres contenant, la DLC ou DDM ne s'applique plus mais c'est la date d'utilisation optimal fournis par le fournisseur qui fait foi.Produits interdit àla vente en vrac
Certains produits ne peuvent pas faire l'objet de vente en vrac : le lait, les compléments alimentaires, les produits surgelés et les produits d'alimentation infantile.
L’article L120-1 précise que tout peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
L’huile d’olive : sa vente en vrac est interdite, mais il est admis que l’opération de remplissage puisse se faire sous les yeux du consommateur, dans un contenant de moins de 5 litres pourvu d’un système de fermeture inviolable, c’est-à-dire qui ne peut être ouvert sans modifier l’intégrité de cette fermeture (un tel système garantit que le contenu de la bouteille ne peut être modifié entre l’emplissage et son utilisation par le consommateur).
Le lait pasteurisé : il ne peut pas être vendu en vrac au consommateur car cette pratique priverait le produit des effets du traitement thermique qui lui a été appliqué et ne serait pas conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques aux denrées alimentaires d’origine animale.
Les produits surgelés : leur vente en vrac est interdite car leur manipulation peut accroître le risque de développement des microorganismes pathogènes au moment de la décongélation.
Produits AOP/IGP : possible de le vendre en vrac dès lors que le cahier des charges n'interdit pas la vente en vrac de manière explicite.
Ex : possible riz de camargue, pas possible lentille du puy
En savoir plus
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-en-vrac-professionnels-quelle-est-la-reglementation
DLC et DLUO
Un suivi rigoureux des dates de péremption dès la reception permet:
- La mise en avant du produit pour favoriser l'acte d'achat.
- Des remises sur le prix à l'apporche de la date pour limiter l'impact sur la marge.
Tableau des consommations: https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/tableau-dlc-inc-2018.pdf
Vente déclassée et seuil de revente à perte
Remise fruits et légumes :https://www.interfel.com/wp-content/uploads/2019/02/guide-des-bonnes-pratiques-en-matiere-de-prestations-de-services-16122015.pdf
Pour les fruits et légumes déclassés, ce qui est possible :
Prix unique au kilo (ex caisse de fruits et légumes abîmés à 2€/kilo), possible si :
- on indique bien que les produits sont déclassés (plus catégorie 1 ou 2)
- on précise bien le prix et l'origine des produits
Vente par lot (lot dans un sac) possible si :
- on indique bien que les produits sont déclassés (plus catégorie 1 ou 2)
- on précise bien le prix et l'origine des produits
- les lots ne concernent que des produits suffisamment gros pour être comptés (pas les petits fruits type cerises ou les petits légumes type pommes de terre nouvelles)
- les lots ne dépassent pas 5 kgs
Remises sur les fruits et légumes, possibles si :
- on indique bien que les produits sont déclassés (plus catégorie 1 ou 2)
- on précise bien le prix et l'origine des produits
Attention, les flegs en remises sont pour les produits déclassés, mais toujours de bonne qualité !
Lien nuage: https://nuage.grap.coop/s/FYQeQHRPJWBGixB
Seuil de revente à pertes (SRP)
Le seuil de revente à perte – ou prix d’achat effectif – représente la limite de prix en dessous de laquelle un distributeur ne peut revendre un produit sous peine d’être sanctionné.
Il est défini par l’article L. 442-3 du code de commerce comme suit : "Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport".
Il y a une différence entre la revente à perte et la vente à perte. Le Seuil de Revente à Pertes concerne l’activité de revente, et non la vente directe par un fabricant.
Il existe des exceptions où le distributeur peut revendre en dessous du prix d’achat effectif :
- quand la date de péremption d’un produit expire sous peu,
- lorsqu’un produit technique est obsolète ou démodé,
- pendant les soldes (elles sont définies par l’article L. 310-3 du code de commerce, pour en savoir plus voir notre fiche sur les promotions et les soldes),
- si, dans une même zone d’activité, un prix plus bas est légalement pratiqué pour le même produit,
- dans le cadre d’une cessation ou d’un changement d’activité,
- lorsqu’on achète un produit à un certain prix, puis qu’on achète le même produit moins cher, on peut alors revendre les produits anciennement stockés en se basant sur le prix d’achat des produits moins chers nouvellement stockés.
Calcul du seuil de revente perte
Le prix d’achat effectif est calculé de la façon suivante :
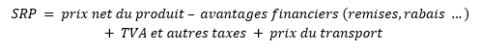
Etiquetage et prix
- PRIX DU PAIN : règles d'affichage du prix du pain
- OEUFS : règles d'étiquetage des oeufs - mentions obligatoires
- ETIQUETAGE FROMAGE : lien vers une fiche complète sur l'étiquetage du fromage au rayon libre service
- FRUITS ET LEGUMES : Règles d'étiquetage des flegs
Lien vers l'outil du CTIFL qui permet de faire le point produit par produit
> Tableau qui récapitule les obligations d'étiquetage des fruits et légume par produit
- ORIGINE DES PRODUITS : étiquetage obligatoire pour les flegs, la viande, les fruits de mer, le miel et tous les ingrédients primaires
En savoir plus
Metrologie- produits pré emballé et en vrac
Lors d’un achat de produit, la quantité délivrée au consommateur doit-être au moins égale à la quantité annoncée. Le consommateur doit disposer de cette information lors d’achat en vrac ou de produit déjà préemballé. Il ne doit pas être lésé.
- Qu’il soit préemballé ou emballé lors de la vente, tout produit doit indiquer son poids, son volume ou son métrage etc.
- La quantité peut toutefois varier dans certaines limites pour les produits préemballés.
- Au marché ou en grande distribution, vérifiez que la balance est en cours de validité et comporte bien un vignette verte datée.
- Lors de la pesée, si l’emballage est posé sur la balance vérifiez qu’elle tient bien compte de son poids.
Produits pré emballés
Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné hors de la présence de l'acheteur, dans un préemballage (bouteille, sac, paquet…), le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit ne puisse pas être modifiée sans ouverture ou modification de l’emballage ou du produit.
Il existe deux grandes catégories de produits préemballés :
• les produits préemballés à quantité nominale, c’est-à-dire du seul produit, (sans son emballage) constante qui sont des produits préemballés dont la quantité est déterminée par le professionnel. Il s’agit par exemple un paquet de biscuits de 200 grammes ;
• les produits préemballés à quantité nominale non constante ou variable qui sont des produits pour lesquels la quantité varie. Chaque préemballage doit indiquer la quantité nominale spécifique. Il s’agit par exemple de la viande vendue en barquette.
Les préemballages doivent contenir en moyenne la quantité annoncée sur l’étiquette. Une quantité minimale doit cependant être garantie. Il est possible qu’un préemballage contienne un peu moins que la quantité affichée, mais selon certaines limites proportionnelles à la quantité vendue. De plus, le nombre de préemballages présentant un déficit de quantité doit être très faible.
Par exemple, un paquet de farine de 1 kg : comme il s’agit d’une moyenne, il est possible qu’il y ait plus ou moins 1 kg selon les paquets mais en moyenne les paquets du lot doivent contenir 1 kg de farine. Par contre, ces variations ne peuvent se faire que dans une certaine limite, dans cet exemple le poids nominal du paquet ne doit pas être inférieur à 0,985 kg.
Unité de mesure des produits
Que ce soit pour les instruments de pesage ou sur les préemballages, il est interdit d’employer pour la mesure des quantités des unités de mesure autres que les unités légales :
• pour les masses : le kilogramme, le gramme, la tonne ;
• pour les volumes : le litre, centilitre ou le millilitre ;
• pour les longueurs : le mètre, millimètre, centimètre, décimètre ;
• pour les surfaces : le mètre carré.
Toutefois, les indications exprimées en d’autres unités peuvent être ajoutées à l’indication en unité de mesure légale.
Pour les denrées alimentaires vendues en préemballages, l’indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées. La quantité nette correspond à la quantité du seul produit acheté, donc sans le poids de l’emballage.
Le signe "e" une garantie de la quantité délivrée
Le signe « ℮ » garantit la conformité du préemballage.
C’est un signe que l’emballeur ou l’importateur peut apposer volontairement. Lorsqu’il l’appose, il s’engage à mettre en place des autocontrôles pour garantir la quantité délivrée.
Le signe « ℮ » présente un intérêt essentiellement commercial, puisque la quantité de produit doit également figurer sur l’emballage. Il constitue un passeport pour les produits destinés à circuler en Europe, puisque tous les préemballages munis du signe « e » doivent respecter les mêmes règles européennes.
Produits vendus en vrac
La vente en vrac correspond à des produits présentés sans emballages, vendus dans la quantité souhaitée par le consommateur et conditionnés dans des contenants réemployables ou réutilisables. Il s’agit par exemple des ventes de fruits et légumes ou de la vente de céréales en libre-service.
Peser correctement
- Les produits qui n’ont pas été emballés, sont pesés en présence des consommateurs.
- Les balances doivent être installées de façon stable, mises à niveau et adaptées au produit pesé.
- Elles doivent être installées de façon que le consommateur puisse vérifier que le poids est à zéro avant la pesée, lire aisément le résultat de la pesée, et, le cas échéant le prix.
- Toute balance utilisée à des fins commerciales doit présenter une vignette verte en cours de validité, prouvant qu’elle a été contrôlée. La vignette doit être visible pour le consommateur.
- Il est interdit d’utiliser un instrument avec une vignette rouge ou une vignette verte dont la date limite de validité est dépassée.
Tenir compte de l'emballage
La tare est le poids d’un emballage ou d’un récipient. La quantité achetée d’un produit correspond à la masse nette c’est-à-dire sans le poids de l’emballage.
Faire la tare, c’est faire afficher à la balance la valeur « 0 » avec l’emballage avant remplissage :
1 – Poser l’emballage vide sur la balance
2 – Faire la tare : la balance indique « 0 g »
3 – Peser la marchandise.
Certaines feuilles de papier, très légères, de poids inférieur à 1 g, peuvent être considérées de poids négligeable. Au contraire, un papier épais utilisé comme emballage peut peser, en fonction de sa taille, jusqu’à 10 g. Pour la vente de 100 g de marchandise au prix de 20 euros le kg, le poids du papier serait de 20 centimes pour l’emballage, ce qui fait un surcoût illégitime de 10 %.
L’instrument est souvent préréglé pour prendre en compte le poids de la tare. Il existe aussi des instruments de pesage électroniques modernes qui mémorisent les poids des différents matériaux d’emballage (feuille de protection, sac, gobelet). Lors du pesage, les valeurs de tare correspondantes sont automatiquement soustraites, de telle sorte que seule la valeur nette est prise en compte pour le calcul du prix.
Balance connectées obligations
Obligation d'affichage du poids à la caisse auprès des clients
Vente en vrac - Bonnes pratiques
Recommandations en terme d'hygiène
Contenants de service à la vente
Matériaux
Il faut veiller à ce que les matériaux entrant en contact avec les denrées, notamment les contenants de présentation, soient appropriés. Tous les matériaux ne sont pas adaptés pour le contact prolongé avec les denrées alimentaires.
Les établissements doivent disposer d’une déclaration de conformité (certificat d'alimentarité) ou, à défaut, s’assurer auprès de leur fournisseur de leurs conditions d’usage : les contenants ne doivent en effet être utilisés que dans des conditions prévues (durée, température, usage répété ou unique...) par la déclaration de conformité ou selon les instructions d’usage de l’étiquetage si elles existent ou, à défaut, selon des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi.
Cette obligation concerne également les sacs de vracs ou autres contenants proposés pour le service au client.
Attention donc aux sacs de vrac artisanaux qui n'ont souvent pas de certificats (ne pas les mettre en vente pour cette utilisation)
Nettoyage
Formaliser les procédures de nettoyage : afficher un plan de nettoyage et conserver les fiches d'enregistrement des actions pour prouver la fréquence de nettoyage des contenants
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements pouvaient proviennent souvent du lieu de vente. Il s’agit dans ce cas de produits à usage domestique. Si le recours à ce type de produit n’est pas interdit, il convient que les professionnels s’assurent toutefois de l’efficacité du processus de nettoyage.
Les lave-vaisselle pro / particuliers ne sont pas adaptés à la désinfection thermique.
Il faut donc dans l'idéal vaporiser un spray désinfectant à base d'alcool apte au contact alimentaire, sans rinçage. Regarder propriété bactéricides, virucides et fongicides.
Séchage:
Torchons ok pour essuyage, si codes couleurs, par exemple, pour éviter les contaminations
Séchage à l'air libre conseillé
Attention à bien ranger les ustensiles lavés dans une zone propre (attention, pour les silos, prévoir cette place)
Danger physique :
Ne pas refermer les sacs de vrac avec des agrafes
Utiliser des cutters à lame non seccable pour ouvrir les sacs de vrac
S'assurer régulièrement que les contenants de distribution ne sont pas endommagés.
Focus sur le risque allergène
La contamination croisée des produits dans les contenants ou par les entonnoirs de remplissage est un risque très probable (utilisation d’un même entonnoir pour remplir toutes les trémies sans nettoyage préalable par exemple).
Le risque allergène peut être important et aller jusqu'au décès d'une personne...
Il y a 14 produits allergènes déclarables : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Allergene-alimentaire
Exemples de bonnes pratiques :
Chaque bac doit servir pour un produit / une pelle par produit ou bac pour les pelles propres et les pelles sales
Attention aux entonnoirs qui peuvent être mis à disposition des clients pour le service
Il faut éduquer les consommateurs.
En service arrière aussi faire attention aux ustensiles de service.
Penser à demander aux boulangers leurs allergènes !
Attention aux produits vendus avec appellation "sans gluten" en vrac = pas possible à partir du moment où on ouvre le sac !
Ce qui est recommandé, c'est que tous les allergènes présents dans le cadre de la vente en vrac soit affiché en caisse et à proximité immédiate des produits.
Changement de lot
La question des mélanges de lot est celle de la gestion de la traçabilité. Il n'y a aucune obligation formelle.
Les mélanges de lots sont parfois pratiqués : certains établissements n’attendant pas qu’une trémie soit vide avant de la remplir. Dans ce cas, les informations transmises par les fournisseurs, notamment celles relatives au numéro de lot, ne sont pas toujours conservées ou fiables. Or, la mise en place d’une traçabilité rigoureuse facilite la gestion d’éventuels retraits et rappels et est également nécessaire pour la gestion du risque lié aux allergènes.
Attention, il est nécessaire de garder l'étiquette d'origine (y compris pour les fruits et légumes)
Nous recommandons de découper l'étiquette de l'emballage du produit en vrac et de l'archiver par ordre alphabétique par exemple pour pouvoir la retrouver facilement en cas de contrôle.
Bien mettre la date d'ouverture sur l'étiquette de vrac qui est conservée
Contenant apporté par le client ou fourni par l'épicerie
L’autre question qui se pose quant aux matériaux entrant en contact avec les denrées est celle du contenant, qu’il soit fourni par le commerçant pour que le consommateur se serve ou apporté directement par le consommateur. Depuis la loi AGEC (voir l’encadré en fin d’article), si le consommateur vient avec son propre contenant, les professionnels sont tenus de l’accepter dès lors que ce contenant n’est pas sale ou inadapté. Le Code de la consommation (article L. 120-2) prévoit qu’un affichage en magasin doit informer le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. Or, si les enquêteurs ont pu constater que cette possibilité est fréquente dans les épiceries 100% vrac ou les magasins bios, elle l’est nettement moins dans les grandes et moyennes surfaces. Ces dernières ont fréquemment exprimé leurs réticences à l’égard de cette pratique qu’elles estiment incompatible avec la vente en libre-service et avec les possibilités actuelles de leurs instruments de pesage.
L'épicerie a la charge du nettoyage/désinfection, il faut les relaver, selon un certain protocole de nettoyage.
Vérifier qu'il n'y a pas de rouille sur les couvercle
N'aller que sur du verre / si plastique, vérifier la présence du logo d'alimentarité
Focus sur la vente et le stockage des œufs
Affichage obligatoire pour la vente en vrac : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-oeufs
Interdiction de mettre à disposition des boites d’œuf qui ont déjà servi. (Problématique salmonelle, mentions obligatoires)
Tolérance que la personne vienne avec sa boite d’œufs
Vendre des boites d’œuf en plastique
DCR (date de consommation recommandée) 28 jours entre ponte et consommation
Extra frais DDM 9 jours
Frais 29 jours
Les oeufs doivent être retirés de la vente 7 jours avant la DCR
Stockage des œufs :
- si réception en réfrigéré, stockage en réfrigéré, mais bien le dire au client
- si réception ambiant, possible de rester en ambiant ou de les mettre au frigo
En cas de forte chaleur, ne pas les laisser à température ambiante.
Autres recommandations
Moulins et systèmes de distribution : penser au demander au fournisseur comment nettoyer correctement la machine et à quelle fréquence. Penser à l'inclure dans le protocole de nettoyage !
Gestion de la perte
Savoir trier et accepter d'écarter
Règle d'or: si je n'achète pas à ce prix là, alors je ne le vends pas.
FOCUS FEL
Au quotidien:
-
Contrôle à reception et tri régulier:
-
Un produit contamié peut en contaminer d'autres
-
Des produits pas frais ne font pas envie- cercle vicieux
-
-
Toujours le plein: une caisse à moitié vide, ne se vend pas, n'hésitez pas à prendre des contenants plus petit quand le stock diminue.
Parer au quotidien pour rafraichir les les produits
Reconditionnement des produits service arrière
Pour des gains de temps, d'énergie et par soucis de praticité certaines épiceries reconditionne des produits de crèmerie (beurre, fromage, crème,...).
Je reconditionne devant le client : autorisé
Je reconditionne pour mettre en libre service: non autorisé
De plus la DLC indiqué sur le produit par le producteur n'est pas la même que celle qui doit être mise sur le produit reconditionné, celle ci doit être la date limite d'utilisation après ouverture fournie par le producteur.
FOCUS ACTI_Traiteur et restauration
Affichages en restauration
Dans un restaurant, plusieurs informations doivent êtreportées à la connaissance du client, sous la forme d'affichage ou de panneaux.
Affichage des prix
L'arrêté du 27 mars 1987 modifié par l'arrêté du 29 juin 1990 fixe les règles applicables en matière d'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.Remarques :
- dans l'établissement où il est perçu un service, le prix annoncé est un prix net (taxes et service compris). Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention " prix service compris " suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service ;
- pour les boissons servies à l'occasion des principaux repas, par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité (voir plus bas, les obligations d'affichage et d'étalage du débitant de boissons), l'affichage peut être remplacé par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l'ensemble des prestations offertes. Cette carte peut être un document distinct du menu et, le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.
Aucune publicité de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente.
A l'extérieur
À l'extérieur, vous devez afficher les prix au comptoir et en salle des boissons les plus souvent servies.
-
pendant la durée du service ;
-
et au moins à partir de 11h30 pour le déjeuner et de 18h pour le dîner.
Dans le cas où certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être mentionnée dans le document affiché.
Dans les établissements ne servant pas de vin, une carte comportant au minimum la nature des boissons et les prix de cinq boissons couramment servies doit être affichée.
Remarque : les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention " boisson comprise " ou " boisson non comprise " et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons : la nature et la contenance offertes.
Vous devez afficher de manière visible depuis l'extérieur de votre établissement et sur la terrasse, les prix des boissons et des plats suivants les plus souvent servis :
- Tasse de café noir
- Demi de bière à la pression
- Bouteille de bière (avec sa contenance)
- Jus de fruit (avec sa contenance)
- Soda (avec sa contenance)
- Eau minérale plate ou gazeuse (avec sa contenance)
- Apéritif anisé (avec sa contenance)
- Plat du jour
- Sandwich
Ces produits et leurs prix doivent être écrits avec des lettres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.
A l'intérieur
Les agents de la répression des fraudes sont habilités à vérifier la conformité de l'affichage de la baisse des prix par rapport aux engagements annoncés et à sanctionner les établissements dont l'affichage est inexact.
Sanctions en cas de défaut d'affichage : amende contraventionnelle de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales).
À l'intérieur, vous devez afficher la liste des boissons et leur prix.
Le prix des plats et de toutes les boissons doit figurer sur la carte (menu).
Utiliser dans le menu ou la carte, le nom exact des plats et des ingrédients. Ils ne doivent pas être trompeurs et doivent être les mêmes que ceux figurant sur la facture du fournisseur. Par exemple, un bloc de foie gras ne doit pas être qualifié de foie gras sur la carte.
La mention et le logo "fait maison" doivent signaler les plats fabriqués de façon artisanale dans des conditions précises.
L'indication des allergènes dans les denrées non préemballées doit figurer sur le menu ou sur un cahier tenu à la disposition des clients.
Vous devez afficher que vous servez gratuitement de l'eau potable, fraîche ou tempérée.
Si le prix inclut le service, vous devez indiquer prix service compris.
Vous ne devez pas afficher de publicité de prix à l'égard du consommateur sur des articles indisponibles à la vente.
Affichage de l'origine des ventes
Le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux restaurateurs de porter à la connaissance de la clientèle l'origine des morceaux de viandes bovines ou de la viande hachée.
L'origine est indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :
-
" Origine : (nom du pays) " lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage du bovin dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays .
-
" Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) " lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.
L'information doit être donnée de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus ou sur tout autre support.
Sanction en cas de défaut d'information sur l'origine des viandes : amende contraventionnelle de 450 euros (2 250 euros pour les personnes morales).
Affichage pour la protection des mineurs et de la répression de l'ivresse publique
Vous devez afficher la réglementation sur la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs (interdiction de vente d'alcool aux moins de 18 ans).
Vous ne devez pas vendre ou offrir gratuitement de l'alcool à un mineur.
Si vous le faites, vous risquez une amende de 7 500 € et une interdiction d'exploiter votre licence pendant 1 an.
Vous devez exiger du client qu'il prouve sa majorité au moyen d'un justificatif.
Il est interdit de laisser entrer un jeune de moins de 16 ans non accompagné par un adulte.
Vous ne pouvez pas employer ou prendre en stage un mineur, sauf si c'est un membre de la famille (jusqu'aux cousins éloignés, dits cousins germains).
Les articles L.3342-1 et suivants du Code de la santé publique imposent l'apposition d'une affiche rappelant les dispositions relatives à la protection des mineurs.
Dans tous les établissements, vous devez afficher le panonceau concernant “ la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique ”, qui doit être immédiatement visible par la clientèle soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir (affiche téléchargeable sur le site internet de la préfecture de police).
Interdiction de fumer et vapoter
Le décret du 15 novembre 2006, en interdisant aux clients des cafés-restaurants de fumer à l’intérieur, a changé les habitudes.
S’il est permis au gérant d’installer les fumeurs en terrasse, c’est parce qu’il s’agit en théorie d’un « espace extérieur », donc non règlementé par le décret d’interdiction de fumer.
Une circulaire du 17 septembre 2008 rappelle ainsi qu’une terrasse est par définition :
- un espace clos (partiellement ou non) mais totalement découvert, OU
- un espace couvert mais au moins ouvert sur son côté principal (façade frontale le plus souvent),
- et surtout, un espace qui demeure cloisonné du reste de l’établissement.
Si ces conditions ne sont pas réunies, les consommateurs doivent fumer dans la rue car il ne s’agit pas d’une terrasse mais d’une simple extension du reste de l’établissement.
Le responsable des lieux qui permet à ses clients de fumer à l’intérieur ou sur une terrasse non conforme à cette description est en infraction et peut être sanctionné.
Texte de la circulaire sur les terrasses.
A compter du 1er octobre 2017 : Il sera théoriquement possible de vapoter dans les bars et restaurants sauf si le ou la responsable d'établissement décide de l'interdire.
Service des boissons et carte des vins
La carte des vins d'un restaurant, qui peut être un document distinct du menu ou être inscrite au dos de celui-ci, doit respecter les obligations suivantes :
-
indiquer si le vin est servi en bouteille ou au pichet ;
-
séparer les vins selon leur type : vin de table, vin de pays (pour lequel le terme « cuvée » est réservé), vin à appellation d'origine contrôlée (AOC) ou vin de qualité supérieure (VDQS) ;
-
utiliser les dénominations de vente réglementaires (nom du vin de pays, nom de l'appellation d'origine) ;
-
mentionner le millésime des bouteilles effectivement en vente ;
-
afficher le prix, le volume net et le titre alcoométrique correspondant
La marque commerciale des vins, les noms de cépage ou les noms de « château » sont des informations facultatives.
Les infractions à cette réglementation sont punies d'une amende de 450 euros (2 250 euros pour les personnes morales). Elles peuvent également être sanctionnées au titre des délits de publicité mensongère et de tromperie.
Si vous servez une boisson au verre, vous devez la verser en présence du consommateur, afin qu'il voie la bouteille d'où elle est issue.
Si le client commande une bouteille entière ou une canette fermée, elle doit être déposée devant lui fermée. Vous devez l'ouvrir en sa présence devant lui.
Affichage de la licence de débit de boisson
Les restaurateurs doivent indiquer à l'extérieur de leur établissement le type de licence qu'ils possèdent. Vous devez afficher une pancarte mentionnant le type de licence.
Autres affichages obligatoires
- La mention et le logo "fait maison" doivent signaler les plats fabriqués de façon artisanale dans des conditions précises.
Seuls les restaurateurs qui servent des plats faits maison,cuisinés sur place à base de produits frais, bruts ou traditionnels (beurre, huile…), peuvent afficher la mention / le logo « Fait maison ».
Si toute la carte n’est pas faite maison, alors il faut mentionner sur la carte quels sont les plats réalisés dans la cuisine de votre entreprise.
- L'indication des allergènes dans les denrées non préemballées doit figurer sur le menu ou sur un cahier tenu à la disposition des clients.
- Le réglement sanitaire départemental
Le nom est un peu rébarbatif, mais il s’agit simplement du règlement en matière d’hygiène et de salubrité qui s’applique à toutes les communes du département.
Affichage non obligatoire mais conseillé par le bonsens
- Horaires et dates d'ouvertures. N'oubliez pas d'indiquez vos vacances.
- Les moyens de paiement
Formation nécessaire pour ouvrir son bar-restaurant
Permis d'exploitation d'une licence de débit de boisson
Permis valable pendant 10 ans. Formation d’un à deux jours en ligne ou en présentiel dans les centres agréés.
HACCP
Il faut qu'au moins une personne de l'activité ait été formée aux normes d'hygiène.
Soit vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine ou d'une expérience de 3 ans en tant qu'exploitant, soit vous allez devoir suivre une formation auprès d'un organisme régional habilité.
Permis de vente de boisson alcoolisé la nuit
Au niveau de la loi, la nuit commence à 22 heures.
Formation de 7 heures.
Si diffusion de + de 6 spectacles/an
Les entrepreneurs qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles.
Ces entrepreneurs peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles (production, diffusion, exploitation de lieux de spectacles) dans la limite de six représentations par an. Au delà, ils doivent détenir une licence d'entrepreneurs de spectacles.
Cette licence s’adresse aux personnes qui pourvoient à l’entretien et à l’aménagement des salles et lieux pour les mettre à la disposition d’un diffuseur ou d’une compagnie, quel que soit le type de contrat. Les directeurs de théâtre ou de salle de concerts ont la responsabilité du respect de la sécurité et de la réglementation applicable aux salles de spectacles.
Le dossier de demande de licence est téléchargeable sur le site de la DRAC du siège social de la structure. Une fois complété il doit être renvoyé à la DRAC en recommandé avec accusé de réception.
La qualité du projet artistique n’est pas examinée, c’est la régularité de la situation du candidat au regard des différentes conditions objectives d’attribution qui est prise en compte.
La licence est délivrée par arrêté du préfet du Département du siège de l’entreprise après avis motivé d’une commission consultative régionale sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence.
N.B : la commission de délivrance des licences se réunissant selon les cas tous les trois ou quatre mois, il est indispensable de se renseigner auprès de la DRAC suffisamment à l’avance sur sa date de réunion et sur les délais de dépôt des dossiers pour ne pas repousser d’autant la date de délivrance de la licence.
La licence d’entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Les demandes de renouvellement doivent être formulées quatre mois au moins avant l’expiration de la licence en cours de validité.
La licence ne peut être accordée qu’au représentant légal ou statutaire de la structure demandeuse. Le titulaire est par conséquent toujours une personne physique, personne physique qui détient la licence au nom de la structure.
S’il s’agit d’une association ou d’un établissement public, la licence est délivrée au dirigeant (président de l’association, directeur salarié, directeur artistique) désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts.
S’il s’agit d’une SARL c’est le gérant ou un représentant salarié (administrateur, directeur artistique) qui sera désigné titulaire de la licence.
Diffusion de la musique
Si vous diffusez de la musique dans votre bar ou restaurant, vous devez demander une autorisation à la Sacem : Sacem : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Vous devez respecter un maximum de niveau sonore pour ne pas déranger le voisinage. Si vous dépassez un certain seuil de décibels sur une durée déterminée, vous devez alors réaliser une étude d'impact sonore auprès d'un bureau d'étude acoustique.
Le tableau des seuils de décibels à respecter en fonction de la durée est disponible sur les sites des l'Agences régionales de santé.
Exposition des boissons non alcoolisées
Vous devez présenter un étalage de boissons sans alcool mises en vente dans l'établissement.
L'étalage doit être séparé de celui des autres boissons.
Il doit être visible à l'intérieur par les consommateurs.
Il doit présenter au moins 10 bouteilles avec un exemplaire de chacune des boissons suivantes :
- Jus de fruits ou de légumes
- Boisson gazeuse au jus de fruits
- Soda
- Limonade
- Sirop
- Eau minérale (gazeuse ou non)
- Eau ordinaire gazéifiée artificiellement ou non
Pour les happy hours, la publicité sur les prix doit être la même pour les boissons alcoolisées ou non.
Bien pensé à renouveler les boissons avant la date de péremption
Normes d'aménagement, de sécurité incendie, électrique
La sécurité alimentaire et la protection des consommateurs sont des éléments essentiels dans le secteur de la restauration, que ce soit pour une cuisine professionnelle ou un laboratoire. C’est pourquoi, des normes précises à respecter ont été mises en place.
Aménagement
Selon la norme CE 852/2004, « l’agencement, la conception, la construction, l’emplacement et les dimensions des locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent permettre leur entretien, leur nettoyage et/ou leur désinfection, offrir un espace de travail suffisant pour l’exécution hygiénique de toutes les opérations, et permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment prévenir la contamination ».
Il est donc essentiel que le plan de la cuisine professionnelle permette d’effectuer toutes les tâches de préparation de la manière la plus rationnelle possible, tout en veillant à la sécurité sanitaire.
Marche en avant
Le principe de la marche en avant permet de respecter cette exigence. Il signifie que de la livraison des matières premières au produit fini, toutes les opérations de production doivent respecter une progression dans l’espace sans retour en arrière ni croisement.
En aucun cas le produit fini ne doit croiser la route de produits intermédiaires, des déchets ou des emballages de matières premières.
Dans le cas d’un local de petite taille, il peut être difficile de mettre en place une marche en avant dans l’espace. Il faudra alors instaurer une marche en avant dans le temps. L’idée est simple : des opérations « propres » et « sales » peuvent se faire sur un même lieu, mais pas en même temps. Pour cela, un protocole précis de nettoyage/désinfection sera mis en place pour permettre la production. Ce protocole de nettoyage et de désinfection devra être décrit, documenté et enregistré dans le PMS.
Normes relatives aux murs et plafonds des cuisines professionnelles
Les murs et plafonds représentent des risques avérés pour la sécurité sanitaire :
- Les contacts avec le personnel, les aliments ou les emballages sont quotidiens au niveau des murs d’un laboratoire. Un mur poreux ou qui s’effrite, des zones difficiles d’accès pour le nettoyage constituent autant de sources de contamination pour le produit fini.
- Les plafonds surplombent l’ensemble du laboratoire alimentaire. Tout élément susceptible de s’en détacher peut potentiellement contaminer un aliment !
Face à ces risques élevés, la réglementation donne des préconisations claires pour les murs et plafonds des laboratoires alimentaires et cuisines professionnelles. D’après le Règlement (CE) N°852/2004 – Annexe II – Chapitre II – Article 1.b et 1.c :
- Les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter. L’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, ainsi qu’une surface lisse jusqu’à une hauteur convenable pour les opérations.
- Les plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher l’encrassement, à réduire la condensation, l’apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules.
Ces recommandations interdisent de facto l’utilisation de certains matériaux comme le bois, le plâtre, certaines peintures et les carrelages dont les joints sont en ciment. Nous recommandons l’installation de plaques murales et de revêtements de plafond en PVC, facilement nettoyables.
Sécurité incendie
Normes incendie en cuisine professionnelle
Deux textes font autorité en matière de norme incendie en cuisine professionnelle.
Le premier est l’Arrêté du 25 juin 1980, qui concerne les « grandes cuisines », c’est-à-dire les cuisines dont la puissance utile totale des appareils de remise en température est supérieure à 20 kW.
Le second est la norme NF EN 16 282 de l’AFNOR, qui concerne plus précisément les obligations en termes d’évacuation et de ventilation des cuisines professionnelles.
Ces textes régissent les normes en matière de :
- Matériaux à utiliser pour les postes de travail, appareils de préparation et de cuisson, hotte, portes coupe-feu, murs et plafonds. Chaque élément doit avoir un certain degré coupe-feu ou une résistance au feu pour un temps défini.
- Mise à disposition de moyens d’extinctions (notamment des extincteurs, dont le nombre doit être adapté à la surface de la cuisine).
Les normes concernant les appareils de cuisson
Les professionnels de la restauration doivent s’équiper d’appareils de cuisson respectant les normes de sécurité incendie. Ils doivent installer un dispositif d’arrêt d’urgence des circuits d’alimentation en électricité et en gaz des appareils de cuisson. Ce dispositif doit être facilement accessible (article GC 4 de l’Arrêté du 25 juin 1980).
L’article GC 5 précise ces obligations : l’installation doit se trouver à une distance de plus de 50 cm des murs si ceux-ci ne sont pas couverts par des matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 (à l’exception des appareils certifiés CE, soumis aux préconisations du fabricant) ; et il faut pouvoir immobiliser les appareils susceptibles d’être renversés ou déplacés.
Enfin, il est nécessaire de prévoir des systèmes d’extinction adaptés aux différents risques (notamment l’extinction des feux d’huile dans le cas des friteuses).
Normes sur l’évacuation d’air et les hottes en restauration
L’Arrêté du 25 juin 1980 (article GC 10) réglemente le dispositif d’évacuation d’air et les hottes chez les professionnels de la restauration. Tout système de ventilation, qu’il soit naturel ou mécanique, doit permettre de conduire l’air et d’évacuer l’air vicié, les buées et les graisses de la manière suivante :
- Les hottes doivent être installées au-dessus des appareils de cuisson et doivent être construites en matériaux M0 ou A2-s1, d0.
- Les différents éléments des dispositifs de captation doivent pouvoir retenir les graisses et être facilement nettoyés et remplacés.
- Les conduits d’évacuation doivent être rigides et fabriqués en métal.
- Les autres conduits et gaines du lieu de restauration dans le bâtiment doivent respecter un degré coupe-feu de 60 minutes minimum.
Electrique
Toute cuisine doit respecter certaines réglementations. Elle doit notamment être conforme à la norme AFNOR NF C 15-100, complétée par le guide UTE C 15-201 qui en précise les modalités en termes de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension. L’Arrêté du 25 juin 1980 apporte des spécificités pour les grandes cuisines, c’est-à-dire les cuisines des lieux de restauration professionnelle.
Le nombre de prises électriques est déterminé en fonction de la taille de la cuisine :
- Pour les prises non spécialisées : 3 prises pour une superficie de moins de 4 m² ; 6 prises pour une superficie de plus de 4 m².
- Pour les prises spécialisées alimentant les appareils électroménagers : 1 pour les plaques de cuisson ou la cuisinière électrique de type 32A en monophasé, d’une prise 20A en triphasé ou d’une boîte de connexion ; 1 pour le four avec une prise 16A ; 1 pour le lave-vaisselle avec une prise 16A ; le lave-linge et le sèche-linge doivent être alimentés par une prise 16A ; et les congélateurs par un circuit spécialisé avec un dispositif différentiel de type F (30 mA).
Il existe une hauteur réglementaire minimale pour l’installation des prises électriques, calculée depuis le sol pour éviter tout contact dangereux avec l’eau :
- Plus de 5 cm pour les prises de 16A ;
- Plus de 12 cm pour les prises de 32A.
En outre, pour l’accessibilité aux personnes handicapées, les prises électriques doivent être installées en dessous d’1,3 mètre du sol.
Pouvant être mise en contact avec l’eau, l’installation électrique doit être étanche et doit pouvoir résister aux lavages à grande eau. Selon sa distance avec le sol, la prise devra répondre à une norme de protection supérieure :
- Du sol à 1,1 m : les prises doivent être protégées contre les jets d’eau (IPX5) ;
- De 1,1 m à 2 m : les prises doivent être protégées contre les projections d’eau (IPX4) ;
- Au-dessus de 2 m : les prises doivent être protégées contre les jets en pluie (IPX3).
Une cuisine professionnelle doit comporter au moins un point d’alimentation d’éclairage, de préférence au plafond. Cette source de lumière doit être au moins égale à 500 lux pour prévenir des accidents.
Une cuisine professionnelle peut installer un appareil de production d’eau chaude sanitaire (ballon d’eau chaude) d’une puissance inférieure ou égale à 70 kW. En revanche, tout appareil de production d’eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche y est interdit.
Cuisine et système d'extraction d'air aux normes
Un local commercial doit être pourvu d’un système d’extraction dès lors que l’activité qui y est exercée implique une cuisson d’aliments, et donc l’émanation de fumées et d’odeurs.
En principe, un locataire ne peut exercer une activité dans les lieux loués que si elle est indiquée dans le contrat de bail, et qu’elle est permise par le règlement de copropriété de l’immeuble s’il en existe. La nécessité de disposer d’un système d’extraction dépendra donc notamment de la clause de destination du bail.
A cet égard, la Cour de cassation retient qu’un local loué avec pour destination une activité de « restauration » doit être pourvu d’un système d’extraction de l’air pollué, conforme à la réglementation en vigueur [1]. Les tribunaux semblent également considérer que l’installation est nécessaire pour une activité de « petite restauration », dès lors qu’elle est de nature à entraîner la diffusion d’odeurs de cuisine [2].
Ainsi, que l’activité autorisée dans le bail soit celle de « restauration », « petite restauration », ou encore « sandwicherie », le critère déterminant semble être l’utilisation de certains moyens de cuissons entraînant des troubles olfactifs, tels que fours, friteuses, appareils à panini ou feux vifs.
En vertu de l’article 1719 du code civil, la présence et la conformité de cette installation incombe au bailleur qui est tenu de délivrer le local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué. Pour transférer cette charge au locataire, une stipulation expresse du contrat de bail doit indiquer que le dispositif d’extraction sera réalisé par le preneur, et ce dernier doit avoir être informé des difficultés techniques attachées à la conduite de tels travaux [3].
Les caractéristiques à remplir pour un système d’extraction conforme.
Avant de créer ou d'acquérir un restaurant même en activité, vérifiez toujours en premier lieu, l'existence et l'état des conduits de fumées ou d'extraction d'air.
Dans un immeuble, il existe plusieurs types de conduits qui doivent être étanches (contrôle obligatoire tous les 3 ans) et isolés les uns des autres:
- Les cheminées maçonnées pour le chauffage,
- Les gaines pour les ventilations sanitaires (mécanisées ou non),
- Les gaines pour la climatisation des locaux et le renouvelement de l'air,
- Les tubage des installations de chauffage ou productions d'eau chaude au gaz,
- Les gaines d'extraction de l'air vicié des cuisines reliées aux hottes de captation situées au dessus des éléments de cuisson.
Les règles définissant la conformité d’un système d’extraction de l’air sont contenues dans le Règlement Sanitaire Départemental, qui prévoit que la ventilation du local doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution. Outre ce réglement, les reglements de sécurtité contre l'incendie, les regelements de copropriétés ainsi que les plaintes éventuelles du voisinage pour le bruit et les odeurs peuvent rentrer en considération.
Pour ce faire et éviter les nuisances, conformément à l’article 63-1, l’installation doit être placée à au moins 8 mètres de toute source éventuelle de pollution, notamment des véhicules et des débouchés de conduits de fumée. Il faut également que l’air extrait des locaux soit rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf.
Cette configuration évite notamment au voisinage du local de souffrir de diverses nuisances liées à l’air rejeté, notamment olfactives.
Les articles 61.1 et 64.2 du même règlement posent également des règles en matière de débit minimums d’air neuf à introduire dans les grandes cuisines d’établissement recevant du public (ERP). En pratique, il faudra généralement que le diamètre de la gaine d’extraction soit au minimum de 400 millimètres pour assurer ces débits minimums sans provoquer de nuisances sonores vis-à-vis du voisinage.
Par ailleurs, les conduits doivent être étanches et isolés les uns des autres. Un contrôle est obligatoire tous les trois ans par une entreprise qualifiée pour s’en assurer.
S’agissant de l’entretien, le tubage métallique servant de conduit pour extraire les vapeurs grasses de cuisine doit être nettoyé au minimum une fois par an par une entreprise spécialisée et qualifiée par un Organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment (OPQCB). Les filtres des hottes (en acier inoxydable ou jetable) doivent quant à eux être entretenus et dégraissés au moins une fois par semaine, ce qui peut être effectué par le personnel de l’établissement.
Certification bio en restauration
Le cahier des charges prévoit :
- La certification « Quantité produits », basée sur les volumes des produits biologiques achetés par l’établissement sur une période (y compris les boissons) selon 3 catégories : de 50 à 75 %, de 75 à 95% et + de 95%. Le % exprime la valeur d’achat de denrées/ingrédients bio dans l’élaboration et la vente des produits.
- La certification « Plat(s) et/ou menu(s) », basée sur le Plat composé d’au moins 95% en poids d’ingrédients et/ou de denrées biologiques ou sur le Menu constitué à 100% de plats ou denrées biologiques (y compris les boissons s’il y a).
- La certification «plat(s) et/ou menu(s)» est indépendante de la certification «quantités produits» sauf pour les restaurants «+ 95%» pour lesquels la certification «plat(s) et/ou menu(s)» est intégrée d’office.
- Un restaurant qui ne propose qu’un plat bio peut se faire certifier en «plats et/ou menus» sans demander la certification «quantité produits».
- Seuls les «+ 95 %» peuvent se revendiquer RESTAURANT BIO
En savoir plus: https://www.bureauveritas.fr/sites/g/files/zypfnx146/files/media/document/FT_Agro_Restauration%200220.pdf
FOCUS ACTI_Vente en gros et B2B
Ventes de vin et spiritueux
Dans le cadre de l'activité de négociant en vin, un certain nombre de formalités ou obligations doivent être respectées.
Déclaration de production des négociants vinificateurs
Le service en ligne « Déclaration de la production de vin d'un négociant » permet aux négociants vinificateurs de saisir leur déclaration de production en ligne et de la transmettre à la douane via le portail douane.gouv.fr.
Les négociants non vinificateurs ne sont pas concernés par la déclaration de production.
Cette déclaration s'effectue obligatoirement sur le service en ligne « Déclaration de la production de vin d'un négociant (SV12) ». La date limite de dépôt est fixée annuellement.
Déclaration de stock des négociants en vin
Les négociants détenteurs de vins déclarent chaque année les informations relatives aux stocks de vins qu'ils détiennent au 31 juillet.
Cette déclaration s'effectue obligatoirement sur le service en ligne « déclaration des stocks de vins et de moûts (STOCK) ». La date limite de dépôt est fixée annuellement.
Les négociants qui ne détiennent pas de stock ne sont pas tenus de déclarer un stock nul.
Le défaut de déclaration dans le délai réglementaire est passible de sanctions.
Déclaration d'enrichissement des négociants en vin
Toute intention d'enrichissement des vins au cours de la campagne, par sucrage, par addition de moût concentré, par concentration des moûts ou par concentration des vins par le froid (congélation) donne lieu à une déclaration préalable d'enrichissement. Avant tout enrichissement l'exploitant doit s'assurer que cette pratique est autorisée pour les vins qu'il produit.
Cette déclaration s'effectue obligatoirement sur le service en ligne « déclaration de pratiques oenologiques (OENO) ». La date limite de dépôt est fixée au plus tard 48h avant la première opération. Cette déclaration d'intention est valable pour toute la campagne.
Déclarationde pratiques oenologiques reglementées
Les pratiques œnologiques suivantes doivent être déclarées :
-
- acidification,
- désacidification
- édulcoration
- désalcoolisation
- traitement au ferrocyanure de potassium.
Ces déclarations s'effectue obligatoirement sur le service en ligne « déclaration de pratiques oenologiques (OENO) ».
Valorisation obligatoire des sous produits de la vinification
Les sous-produits de la vinification (marcs, lies et bourbes) doit être valorisé. Les négociants vinificateurs ont la possibilité de valoriser :
-
- leurs marcs via l'envoi à une distillerie, unité de compostage et/ou unité de méthanisation ou en procédant au compostage ou à la méthanisation (sur l'exploitation) ou à l'épandage (sur l'exploitation ou sur celle d'un tiers) ;
leurs lies via l'envoi à une distillerie, unité de compostage et/ou unité de méthanisation.
- leurs marcs via l'envoi à une distillerie, unité de compostage et/ou unité de méthanisation ou en procédant au compostage ou à la méthanisation (sur l'exploitation) ou à l'épandage (sur l'exploitation ou sur celle d'un tiers) ;
D'après les données contenues dans la déclaration de production, le service en ligne REV permet au négociant vinificateur de connaître la quantité d'alcool à obtenir à partir des sous-produits de sa vinification.
En cas de livraison des marcs et/ou des lies à une unité de compostage ou une unité de méthanisation, les négociants vinificateurs doivent s'assurer que ces opérateurs ont bien été enregistrés auprès des services de FranceAgriMer (Ministère de l'Agriculture).
Le producteur de sous-produits doit tenir un registre spécifique reprenant les quantités et les teneurs en alcool total.
Les négociants vinificateurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de moûts ou de vins au cours d'une même campagne sont notamment dispensés de cette obligation de valorisation. Vous pourrez retrouver la liste des opérateurs dispensés dans le décret 2014-903 du 18 août 2014 relatif à la valorisation des résidus de la vinification.
Les négociants sont également soumis au respect de la réglementation environnementale.
Dégustation et licence de débit de boisson
Pour y voir plus clair, il semble tout nécessaire de définir un mot essentiel : dégustation. Selon Vin & Société dans son Guide la dégustation, on entend par dégustation : « une opération consistant à juger de la qualité d’un vin à partir des impressions qu’il provoque à l’odorat et au goût ». La « dégustation est une consommation d’alcool ».
- Si vous faites déguster vos vins sur votre exploitation, vous n’avez pas besoin d’une licence de débit de boissons.
- En revanche, si la dégustation porte sur des vins élaborés avec des raisins achetés à un autre viticulteur, il vous faudra une licence.
- De même, si vous organisez une dégustation payante, une licence est nécessaire car elle s’apparente alors à une vente à consommer sur place.
- Toutefois, si cette dégustation payante se déroule dans les locaux de votre exploitation et ne concerne que vos propres vins, vous êtes, en principe, dispensé de cette obligation.
FOCUS ACTI_Brasserie
Guides des bonnes pratiques des lieux de brassage
Hygiène: https://agriculture.gouv.fr/sites/default/files/gph_20085917_0001_p000_cle01d12f.pdf
Réglementation et démarches propres aux brasseries
Inscription au repertoire des métiers
Comme pour toute activité artisanale, un porteur de projet doit se rendre auprès de la Chambre de métiers et de l'Artisanat dont il est le ressortissant pour entamer les diverses démarches administratives relatives à son immatriculation au Répertoire des Métiers. Il s’adressera au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui lui indiquera la démarche à suivre.
Devenir entrepositaire agréé
L’artisan devra se rendre auprès des services des Douanes territorialement compétent pour devenir « entrepositaire agréé ». Cette démarche est obligatoire dès que la production et le stockage de bière dépasse 110 litres.
Les Douanes demanderont le dépôt d’un dossier d’agrément et d’identification déclarant l’identité (nom, prénoms, raison sociale et adresse exacte de l'entreprise) et la nature de l’activité.
Le dossier devra aussi comporter, entre autres, diverses pièces :
-
- Le plan de situation et plan détaillé du ou des locaux
- Une autorisation d’établissement ou d’exploitation et/ou l’extrait du registre du commerce (Kbis)
- Les statuts de la société
- Les derniers bilans comptables – sont exemptées les entreprises nouvellement créées
Le service des Douanes a mis en ligne une fiche complète détaillant les différents documents à fournir et les obligations liées au statut d’entrepositaire agréé.
Lien nuage: https://nuage.grap.coop/s/cH8SLNENWHLJ3c2
Déclaration d'activité auprès de la municipalité
La mairie de la commune où la production de bière s’effectue devra être contactée au préalable pour effectuer une déclaration d’activité. Elle pourra donner son accord pour autoriser la production.
La municipalité pourra aussi notifier son refus si le futur artisan souhaite s’installer, par exemple, dans une zone où l’exercice de l’activité n’est pas autorisé.
Si la quantité de bière brassée est supérieure à 2000 L par jour, le producteur ne s’adressera pas à la mairie mais à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement qui délivrera alors l’autorisation.
Si pas utilisation de l'eau public
Si le producteur ne souhaite pas utiliser l’eau du réseau public pour la fabrication de sa bière, il devra contacter la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales qui viendra effectuer des tests sur la qualité de l’eau. La DDASS se réserve la possibilité de revenir régulièrement pour s’assurer que l’eau utilisée continue à respecter les standards de qualité.
Petite licence à emporter et licence III
- La petite licence
Dans les cas où une vente à emporter de la production est mise en place, il faudra faire la demande d’une « petite licence à emporter ».
Cette dernière permet à un établissement de vendre de l’alcool de 3e catégorie : les boissons fermentées mais non distillées, telles que la bière, en font partie.
Cette licence vise seulement les ventes à emporter.
La démarche pour l’obtenir se fait auprès la mairie du lieu de l’établissement. Elle est gratuite et il faudra fournir une pièce d’identité ainsi que les projets de statuts ou un extrait de K bis de moins de trois mois si l’entreprise est déjà créée.
- La licence III
La licence III est demandée pour la vente sur place (formation « permis d’exploitation » obligatoire).
Si accueil du public
Si une brasserie prévoit de recevoir du public, elle sera classée comme un ERP et devra satisfaire les exigences d’accessibilité relatives à ce type d’établissement.
Reglementation sur l'étiquetage des bouteilles
Une fois l’installation faite et la production lancée, la mise en bouteille et l’étiquetage des bouteilles de bières vont également répondre à certaines règles, notamment en ce qui concerne la qualité de « bières artisanales ».
D’une manière générale, une étiquette doit donner une information loyale au consommateur.
Afin d’avoir une aperçu des différentes mentions obligatoires, la DCCGRF a rédigé en collaboration avec Brasseurs de France une fiche étiquetage qui donne les grandes lignes réglementaires.
L’absence des mentions obligatoires conduit à présenter des produits non conformes
FOCUS ACTI_Boulangerie/ Patisserie
Formation et pré requis
Études possibles
- Niveau CAP
- CAP boulangerie (obligatoire - très recommandé)
A défaut de CAP boulangerie, il faut présenter 3 ans de fiches de paie en tant que boulanger pour pouvoir ouvrir une boulangerie ; autrement, il est possible d'ouvrir un Fournil, mais interdiction de l'appeler boulangerie
-
- MC (mention complémentaire) boulangerie spécialisée
- MC (mention complémentaire) pâtisserie boulangerie
- CQP tourier snacking (apprendre à préparer les pâtes)
- Niveau Bac
- Bac pro boulanger pâtissier
- BP (brevet professionnel) de boulanger
- Niveau Bac + 2
- Brevet de maîtrise boulanger accessible via le réseau des chambres des métiers
- Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques production et transformation spécialité arts et métiers de bouche
Stage
Stage de préparation à l'installation (si l'activité de boulanger est au moins en partie artisanale).
Dérogations possibles : diplôme de gestion, gérance d'une entreprise par le passé...)
Règles
Règles à respecter
inscription obligatoire au répertoire des métiers + potentiellement à la CCI
- Respect des normes d'hygiènes concernant le nettoyage et la désinfection des lieux de confection, la cuisson, la conservation des aliments
Guide des bonnes pratique d'hygièneen patisserie: https://nuage.grap.coop/s/R6k2cBrpDpqmoB3
- Respect des règles de sécurité en matière d'incendie ou d'accès des personnes handicapées
- Affichage des prix selon les pains, les prix à la pièce et le prix au kilo --> l'affichage du prix du pain doit être visible de l'extérieur
- Réglementions stricte encadrant les noms donnés aux pains. En effet, il y a une réglementation pour certains pains : tradition, pain au levain, pain de seigle (différent du pain au seigle). Également, attention à l'appellation "cuit au feu de bois", qui implique obligatoirement que la flamme passe dans la chambre de cuisson (= chauffe directe). Sinon, il faudra jouer sur les mots (four chauffé au bois)
- Surface de travail : selon Emmanuel (accompagnateur), les surfaces en bois sont interdites car non-inertes (ou non lessivables ?). Dérogation concernant le pétrin en bois du fait de son caractère traditionnel.
Etiquetage du pain
Les règles d’étiquetage concernant le pain
Toutes les catégories de pain mis en vente par le boulanger doivent être accompagnées d’écriteaux de dimension supérieure ou égale à 15 cm de longueur et de 2,5 cm de hauteur.
Les écriteaux doivent être facilement visibles par les clients.
Enfin, il est nécessaire que tous les écriteaux soient fixés à la base des étales où les pains sont exposés.
Mentions sur les écriteaux
Sur l’ensemble des écriteaux, il faut faire figurer plusieurs éléments :
-
- Le nom du pain
- Le prix de vente à la pièce ou au kilo, selon le produit concerné
- Le poids en grammes. Inutile lorsque le poids est inférieur à 200 grammes
Les écriteaux doivent être couplés d’une affiche répertoriant l’ensemble des prix pratiqués
Cette affiche, située à au moins 2 m de hauteur dans le point de vente, doit avoir une taille minimale de 40 cm de hauteur sur 30 cm de largeur. Elle doit obligatoirement être blanche avec le texte en noir, pour faciliter sa lecture. Cette affiche a comme titre de manière arbitraire : « Prix du Pain ».
Les indications mentionnées sur l'affiche, comme les chiffres et les lettres, sont aussi réglementées et doivent avoir une taille minimale.
-
- Les chiffres, notamment le prix, doivent être plus visibles que le reste. Ils doivent respecter une taille minimale de 2 cm de hauteur et de 1 cm de largeur.
- Les lettres, indiquant la dénomination du pain, doivent avoir une hauteur de 1 cm et une largeur de 0,5 cm. Enfin, il est nécessaire que tous les écriteaux soient fixés à la base des étales où les pains sont exposés. A noter que cette affiche peut être diminuée de moitié, si elle est située en vitrine et visible de l’extérieur du point de vente.
Règles similaires pour les pâtisseries - viennoiseries
En ce qui concerne les viennoiseries et pâtisseries, elles doivent être présentées avec leurs dénominations et leurs prix. Pour les produits vendus au poids, le prix au kilo ou au 100 g doit être indiqué. L’écriteau devant être situé à proximité des produits.
Si les produits proposés sont décongelés, il est exigé que la dénomination « décongelé » soit mentionnée.
Pour les produits préemballés
Pour les produits préemballés, l’étiquetage doit être présent sur l’emballage et doit indiquer les mentions suivantes :
- poids net ;
- liste des ingrédients par ordre décroissant ;
- allergènes majeurs ;
- conditions de conservation ;
- date de fabrication, date limite de consommation ou date limite d’utilisation optimale ;
- raison sociale et adresse du fabricant.
Les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur et les denrées préemballées en vue de leur vente immédiate, ne sont pas considérées comme préemballées.
Métrologie
Obligation d’avoir une balance certifiée ?
Vente à l’unité SANS découpe
Pas besoin de balance certifiée
En cas de vente à l’unité AVEC découpe
-
Si tu coupes un pain en 2 pour un client qui ne veut qu'une moitié, pas besoin de balance certifiée, tu divises le prix par 2
-
si tu coupes des plus petits morceaux là il te faut la balance certifiée car le poids va être irrégulier et il faut pouvoir prouver que le poids affiché est bien conforme à la métrologie légale.
En cas de vente de produits préemballés
S’il y a vente de produits emballés sur le marché (type biscuits emballés à l’avance), pas obligatoire d’avoir une balance certifiée
FOCUS ACTI_ Commerce non sédentaire
Carte de commerçant
COMMERCANT NON SEDENTAIRE
Est considéré comme activité ambulante, toute profession ou activité exercée sur la
voie publique, les halles, marchés.
Pour exercer son activité :
Le commerçant ambulant doit être inscrit au Registre du Commerce (du lieu de son
domicile) et doit obligatoirement posséder une carte permettant l’exercice d’activités
ambulantes et fournir un extrait Kbis à jour.
ATTENTION : Si vous êtes une activité intégrée vous devrait utiliser la carte commerçant GRAP, sinon vous devez en faire la demande :
Pour obtenir cette carte, les personnes qui souhaitent exercer une telle activité ou la
faire exercer par leur conjoint, doivent s’adresser au CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES (C.F.E.) compétent : la Chambre de Commerce et d’Industrie pour les commerçants ou la Chambre de Métiers pour les artisans, et artisans commerçants.
La carte sera valable 4 ans (au lieu de 2 ans jusqu’à présent) et renouvelable à l’issue de cette période.